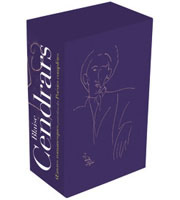 « Blaise Cendrars » : la seule évocation du nom fait trembler la voix et la plume de lyrisme. De ce lyrisme de la modernité, de l’aventure. La cause est entendue, Cendrars, dont la Pléiade collige aujourd’hui les poésies complètes et l’oeuvre romanesque (après les deux volumes d’oeuvres autobiographiques parus en 2013), serait l’incarnation de cette poussée vitale, de cet élan esthétique et existentiel qui a animé le XXe siècle commençant. Mais on se rappelle le merveilleux Lotissement du ciel (Pléiade, Œuvres autobiographiques complètes, tome II) et la fascination de Cendrars pour Joseph de Cupertino – le saint innocent qui lévitait et, prouesse supplémentaire, pouvait voler en marche arrière. Et on se rappelle aussi la grande césure, au propre et au figuré, de sa vie : 1915, le jeune Suisse Sauser n’est pas encore le Français Cendrars, blessé au front, il est amputé de la main droite. Translation et symétrie : il devient gaucher. Après la marche arrière, voici un autre renversement. Le renversement, telle est la dynamique fondamentale de Cendrars.
« Blaise Cendrars » : la seule évocation du nom fait trembler la voix et la plume de lyrisme. De ce lyrisme de la modernité, de l’aventure. La cause est entendue, Cendrars, dont la Pléiade collige aujourd’hui les poésies complètes et l’oeuvre romanesque (après les deux volumes d’oeuvres autobiographiques parus en 2013), serait l’incarnation de cette poussée vitale, de cet élan esthétique et existentiel qui a animé le XXe siècle commençant. Mais on se rappelle le merveilleux Lotissement du ciel (Pléiade, Œuvres autobiographiques complètes, tome II) et la fascination de Cendrars pour Joseph de Cupertino – le saint innocent qui lévitait et, prouesse supplémentaire, pouvait voler en marche arrière. Et on se rappelle aussi la grande césure, au propre et au figuré, de sa vie : 1915, le jeune Suisse Sauser n’est pas encore le Français Cendrars, blessé au front, il est amputé de la main droite. Translation et symétrie : il devient gaucher. Après la marche arrière, voici un autre renversement. Le renversement, telle est la dynamique fondamentale de Cendrars.
Les poèmes, d’abord. Cendrars, c’est un truisme lagarde-et-michardien, était un des astres de la modernité poétique du commencement du siècle dernier, aux côtés d’Apollinaire et tant d’autres. Mais décapons le commode vernis d’histoire littéraire qui a tendance à figer ces textes, reprenons-les, et leur dynamique si particulière opère de nouveau. Relisons Les Pâques à New York, ces distiques qui s’élèvent en prière dans la Grosse Pomme du début du XXe, mais s’achèvent sur ce « Je ne pense plus à Vous. » Décentrement, désaxement : le pivot du poème et du monde n’est plus Dieu mais l’homme. Ou encore la Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France (1913), et l’alchimie verbale de ses rythmes qui font renaître celui du train – mais se psalmodient aussi comme une prière. Mais cette litanie ne monte pas vers le Seigneur, elle se fond dans les champs de couleurs des illustrations de Sonia Delaunay. Le poème se mue en peinture, le verbe se renverse, se transforme en son grand rival dans l’ordre de la représentation : l’image. Il faudrait évoquer aussi La Guerre au Luxembourg (1916) où des enfants jouent à la guerre, mais où le jeu est étonnamment proche de ce qui semble être son exact contraire : le réel. En l’occurrence les atrocités de la Première Guerre mondiale. Sans oublier Documentaires (1924), géniale supercherie littéraire qui voit Cendrars bâtir de bric et de broc ses poèmes en désossant et en ravaudant des bouts du roman de Gustave Le Rouge, Le Mystérieux docteur Cornélius. Ou comment le romanesque bascule dans le poétique.
Même esthétique du balancier dans les romans de Cendrars. Dan Yak, qui ajointe en fait deux romans, Le Plan de l’Aiguille et Les Confessions de Dan Yak, n’est pas seulement l’odyssée extravagante d’un millionnaire, où il est question d’Antarctique et de création artistique. C’est aussi une insolite et géniale opération de transaction, où vie et mort, sauvagerie et modernité, s’échangent comme les deux faces d’une même pièce. A moins qu’on ne songe à une autre démonétisation, bien réelle celle-ci : la ruine du général Suter dans L’Or, la Merveilleuse Histoire du général Johann August Suter (1925). Du tout au rien, de la richesse à la ruine. Mais sans doute est-ce Moravagine (1926), cette épopée picaro-délirante d’un fou criminel (on pense à Dostoïevski, à Céline quelques années après), qui cristallise le mieux cette instabilité permanente, cette façon quasi baroque dont tout est réversible chez Cendrars : le fou et le médecin, le romanesque outrancier et l’Histoire bien réelle, la course autour du monde et la stase. Blaise Cendrars, écrivain total, tient ensemble tous les contraires.
Blaise Cendrars, Œuvres romanesques, précédé de Poésies complètes, édition publiée sous la direction de Claude Leroy, coffret de deux volumes, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2912 p., 115€











