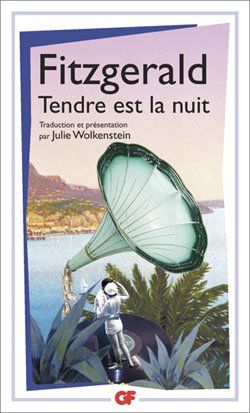 Au coeur des années folles, un couple d’américain en exil, mène grand train sur la Riviera entre bars d’hôtels et villas de milliardaires, une coupe de champagne à la main, cueillant le jour et la nuit dans l’éternel présent de la fête. Tendre est la nuit, le grand roman de Fitzgerald, dans une nouvelle traduction de Julie Wolkenstein, est une descente aux enfers aux apparences glamours mais impitoyable dans la déchéance annoncée.
Au coeur des années folles, un couple d’américain en exil, mène grand train sur la Riviera entre bars d’hôtels et villas de milliardaires, une coupe de champagne à la main, cueillant le jour et la nuit dans l’éternel présent de la fête. Tendre est la nuit, le grand roman de Fitzgerald, dans une nouvelle traduction de Julie Wolkenstein, est une descente aux enfers aux apparences glamours mais impitoyable dans la déchéance annoncée.
« Je n’ai pas connu Fitzgerald ! ». Julie Wolkenstein, la traductrice de Tendre est la nuit, vient me rappeler cette évidence. Ma question était peut-être trop ambiguë et se résumait en fin de compte à un « Comment va donc ce vieux John ? ». Mais qui n’a jamais croisé l’ombre de John Scott Fitzgerald sous le blason de l’université de Princetown au Harry’s Bar ou au rythme d’un fox-trot à la Closerie ? Et dans les cocktails du bar de l’hôtel Savoy de Londres, il subsiste encore la trace de cette folle jeunesse des années 1920, telle une petite olive qui flotte dans un océan de gin. Sous le terme de Génération perdue, se retrouvent tous ceux qui sont arrivés trop tard pour connaître la guerre, à la différence de Barbusse, D’annunzio, ou Cendrars et qui épanchaient dans l’alcool la culpabilité de n’avoir pas participé au grand carnage de 14-18.
Fitzgerald, nous dit Julie Wolkenstein dans sa remarquable préface, est issu de cette génération qui rêvait d’égaler ou de surpasser les anciens, et en imaginant son roman Tendre est la nuit, Fitzgerald avait crânement annoncé à son éditeur qu’il allait surpasser Joseph Conrad, rien de moins ! Ce côté orgueilleux, méprisant, hautain, empreint d’un sentiment de supériorité, qui caractérise la personnalité de l’écrivain, ne rebute pas la traductrice, « Je l’aime bien » dit-elle, comme si, contrairement à l’exclamation de départ, elle l’avait effectivement rencontré, et avait succombé au charme qui émanait de sa personne, au point d’être enfin la seule traductrice à rendre fidèlement en français le style et la poésie étrange de Fitzgerald. Julie Wolkenstein admet cependant l’aspect déplaisant de l’américain dans son désintérêt pour les peuples et les pays européens qu’il parcoure en wagon lits, paquebots et avions. On ne retrouve pas chez lui la passion de la culture européenne qui animait Ezra Pound à la même époque. Le monde qu’il traverse n’est qu’un gigantesque hall d’hôtel, où l’on fait parfois des rencontres dangereuses avec des indigènes français italiens, anglais, dégénérés, violents, arrogants, snobs, et mesquins. Cette focalisation sur un présent dépouillé de toutes racines est brillamment illustrée par la description du palais de Retz comparé à un mélange de porridge et de haschisch. C’est comme si la beauté même de l’architecture était vouée à n’être plus qu’une coquille vide face au mensonge et à l’illusion du passé. Fitzgerald illustre jusqu’à la caricature l’aristocrate américain du sud, comme le fut H.P.Lovecraft en version Nouvelle Angleterre. Il s’imagine en outre faire partie de la « race des riches », cette folle idée, qu’Hemingway épingle dans son roman Les Neiges du Kilimandjaro, à propos du personnage de Julian, avatar de Fitztgerald :
« Pauvre Julian avec son admiration romantique pour les riches (…) Il pensait qu’ils étaient une race exceptionnellement glamour, et quand il a constaté qu’ils ne l’étaient pas, ça l’a détruit tout autant que le reste, qui fut un épouvantable naufrage. »
La réponse de Fitzgerald au traumatisme de la grande guerre, aux orages d’acier qu’il n’a pas connu, c’est la fuite en avant dans le présent qui se consume dans la fête et l’alcool. Il existe d’ailleurs une étrange similitude entre le personnage de Jacques Rigaut dans le Feu follet de Drieu La Rochelle et l’univers de Fitzgerald, comme si cette problématique était moins singulière que générationnelle. C’est finalement cette même insatisfaction que l’on retrouve, exprimée sous la forme du nationalisme et du terrorisme chez le réprouvé Ernst von Salomon en Allemagne ou l’attrait de l’aventure et de la lutte antifasciste chez le norvégien Nordahl Grieg. Tendre est la nuit devient alors cette longue descente aux enfers qui commence dans le paradis de la Riviera et qui conduira le protagoniste à accompagner la folie de sa femme de cliniques en sanatorium, et à noyer passé et futur dans l’alcool. Contrairement au personnage de Somerset Maugham dans The Razor Edge, il n’existe pas de possibilité d’évasion mystique chez Fitzgerald, seulement un enfermement de plus en plus angoissant. Il n’y a même pas ce présent qui est prémonition et présage de mort qui plane dans le Volcan mexicain de Lowry. Le passé y semble définitivement éteint et le futur, même tragique n’existe que sous la forme d’un long pourrissement. Un peu comme Kafka qui comparait sa vie à l’immobile dépérissement d’une dent cariée. À la fin de sa vie, Fitzgerald avait voulu remanier son roman et passer d’un plan diachronique à un plan chronologique, plus accessible, plus bourgeoisement acceptable. Hemingway, bon observateur, avait vite compris qu’il s’agissait d’une erreur qui détruisait la structure narrative et Julie Wolkenstein est catégorique : « Hemingway avait raison ». Même à travers les différentes versions, ce grand roman montre l’incapacité de Fitzgerald à s’ancrer dans une seule certitude, et le présent, son dernier refuge, s’avère être une boussole folle qui flotte dans une flaque de whisky, telle cette dernière partie du roman entièrement rédigée sous l’influence de l’alcool. Le roman est en outre traversé par une mystérieuse occultation que la traductrice appelle « la disparition du crack » ou l’absence totale, dans le roman, de la grande crise de 1929 qui vit la fin définitive de l’insouciance des années vingt. Cet événement tel un cadavre sans corps, constitue bien une enquête paralittéraire au coeur de l’oeuvre. On se posera la question de savoir comment Fitzgerald n’a pas senti le vent venir depuis son théâtre européen alors que 9 000 banques américaines faisaient faillite ? S’agit-il d’un momentum entre le temps long de la vieille Europe et les contrecoups de la crise qui arrivent décalés depuis l’Amérique ? La France est effectivement touchée à partir du second semestre de 1930, soit six mois plus tard. Dans Tintin en Amérique, Hergé ne consacre d’ailleurs qu’une seule image à la crise et ce n’est qu’en 1932 que la Banque nationale de Crédit, qui était la quatrième banque française, fait faillite. Quoi qu’il en soit, tout est disparition dans Tendre est la nuit : la disparition du crack, la disparition du passé, et la disparition de l’Amérique et la progressive disparition de son épouse Zelda, dans la folie. Tout annonce finalement cette feuille blanche, l’impossibilité d’écrire qui hantait l’écrivain. Ce roman crépusculaire est bien l’histoire d’un homme qui disparaît écrasé par un passé définitivement perdu et qui n’est plus en lui-même que le germe asséché de ce qu’il pourrait être. On pense immédiatement au philosophe Héraclite qui affirmait que tout est flux et qu’on ne se baigne jamais dans la même rivière. Fitzgerald montre que cette rivière du temps se transforme en ruisseau, flaque d’eau et, en une dernière larme amère, ou la nostalgie de l’instant qui meure. Le secret de la disparition Fitzgeraldienne apparaîtra en 1935, un an après la publication de Tendre est la nuit dans une nouvelle appelée la Fêlure en français, mais dont le titre anglais The Crack-Up, implique la réapparition du crack occulté, sous une forme de testament désespéré et une poésie de la fin, résumant ainsi sa longue nuit blanche :« Au coeur de la nuit, une valise perdue a la même importance tragique que la peine de mort, et il n’existe aucune consolation car dans la nuit noire de l’âme, jour après jour, il est toujours trois heures du matin. »
Tendre est la nuit, Fitzgerald. Traduction et présentation par Julie Wolkenstein. Flammarion. Paris. 2015







