A la fin du premier roman de Maylis Besserie, on peut lire : « Certes Samuel Beckett a bien existé, certes il a fini ses jours dans une maison de retraite nommée le Tiers Temps, à Paris où il vivait exilé depuis un demi-siècle. Pourtant ce livre est un roman. Mon entreprise n’est pas biographique. Elle a consisté à faire de Beckett, à partir de faits réels et imaginaires, un personnage face à sa fin, semblable à ceux qui peuplent son œuvre. »
Ces évidences pataudes, ces phrases sans langue cachent pourtant un bon livre. Et puis curiosity kills the cat. J’avais envie de rencontrer cette audacieuse qui entrait dans la carrière en faisant parler Sam le taiseux, et de le faire parler qui plus est en fin de vie, en fin de partie, avec cette idée un peu folle par ailleurs, voire complétement folle et sainte-beuvienne, que l’écrivain ressemblait forcément aux personnages qui peuplaient ou plutôt dépeuplaient son œuvre. Partant de ce principe un peu premier degré, est-ce que Maylis Besserie ressemblait elle aussi à Samuel Beckett ? Avait-elle le front haut, ce visage parcheminé de rides comme si la vie lui avait écrit dessus ainsi que ce regard d’épervier maigre, si caractéristiques de l’auteur d’En attendant Godot ? Portait-elle un col roulé noir et une veste en tweed ? Buvait-elle du scotch ? Je repensais aux célèbres photos de l’écrivain par Richard Avedon que j’avais vues, dans des tirages immenses, ornementant les murs du bureau d’Alain Minc, un jour que j’étais allé l’interviewer. Sollers en avait été lui aussi frappé et en avait parlé sarcastiquement dans l’un de ses romans. Beckett chez Minc. Beckett personnage d’un premier roman dont – qui sait ? – quelqu’un aura peut-être envie de faire un film. J’imaginais déjà Lambert Wilson se préparant pour le rôle : après l’abbé Pierre, après De Gaulle, Samuel Beckett… Cela aurait-il de la gueule ? Mais c’était la pente de nos jours : la littérature devenait un produit dérivé d’elle-même, où l’exofiction et le biopic régnaient en maîtres.
Or non, quand je la rencontre, je ne trouve pas que Maylis Besserie ait à proprement parler une allure beckettienne. C’est une femme d’une trentaine d’années, au visage lisse, aux cheveux noirs. Je ne suis pas vraiment surpris d’apprendre qu’elle est native de Bordeaux. Pour le reste, elle se montrera un peu taiseuse avec moi, comme son héros. Curieux comme ceux qui se servent de la vie des autres rechignent à raconter la leur. Je vais juste apprendre que Maylis Besserie a fait Sciences-Po puis un stage à France Culture, et qu’elle y est restée. Elle devient productrice et signe un grand nombre d’émissions sur la littérature ou pas. L’été, il lui arrive de remplacer Olivia Gesbert à la Grande Table. On lui a bien confié un temps une émission quotidienne, mais elle a trouvé cela trop prenant, trop rigide, me dit-elle. On la sent anxieuse de conserver sa liberté. Elle collabore aussi régulièrement au Monde des livres et semble peinée que je l‘ignore. En surfant sur le site du quotidien de référence, je tombe effectivement sur les nombreux articles qu’elle a signés (dont une recension du dernier roman de notre ami Damien Aubel, preuve de goût). Maylis Besserie écrit souvent sur les écrivains anglo-saxons qui sont sa spécialité, telle la nouvelle star des lettres irlandaises Donal Ryan ou bien encore l’écossaise Ali Smith. A propos d’Automne, le dernier roman d’Ali Smith paru chez nous en novembre, Maylis Besserie écrit ainsi que le héros du livre, un centenaire, « est suspendu entre deux mondes. A la maison de retraite de Maltings Care, il dort et rêve, sans mourir, sans se réveiller. Mourir ou dormir ? La narration d’Ali Smith fait son nid dans cette alternance. L’homme respire encore mais sa vie est devenue un rêve plus long que tous les autres. Dans cet interstice, l’auteure écossaise multiplie les images poétiques, les mini-scénarios qui poussent et se fanent comme des roses, qui font mille livres en un. » C’est marrant. A la maison de retraite du Tiers-Temps, sise rue Rémy-Dumoncel dans le 14ème, Samuel Beckett fait exactement la même chose, et son reste d’existence quasi immobile (il se déplace avec difficulté, fait quelques pas dans le quartier, bientôt il ne pourra plus) se décline en songeries comme autant de petites nouvelles qui le ramène souvent à sa mère et à l’Irlande peu nourricière. « Je connais bien ce pays, me dit la primo-romancière, j’y vais souvent depuis mon adolescence. On ne se rend pas bien compte ici combien Beckett est irlandais. Les Français essaient de se l’accaparer mais son humour noir, c’est celui des pubs irlandais ».
Pour le reste, la naissance de ce premier roman est en soi une petite histoire bien de notre époque. Maylis Besserie m’apprend en effet qu’elle a participé aux ateliers d’écriture de la NRF, créés en 2012 par Charlotte Gallimard. Elle a opté pour l’un des ateliers les plus courus, celui qui s’intitule « La fabrique du récit » et qui est dirigé par Jean-Marie Laclavetine. Le même qu’avait suivi une certaine Leïla Slimani avant d’écrire son premier roman. « Cela se passe le soir dans les salons de Gallimard » raconte Maylis Besserie. « On est une dizaine de participants. Un jour que Laclavetine nous avait demandé d’écrire la première ou bien la dernière page de notre roman, je m’étais mis en tête d’écrire quelque chose sur la relation qui unissait James Joyce et Samuel Beckett qui fut, comme on le sait, son secrétaire. » Lorsque Maylis Besserie me narre cette anecdote, je ne peux m’empêcher de repenser au chapitre que Maurice Nadeau consacre à Beckett dans ses Mémoires littéraires. « Vous n’auriez pas envie de raconter vos années avec Joyce ? » demande un jour le journaliste à l’écrivain. « Jamais je ne parlerai de Joyce, répond ce dernier, j’ai un trop grand respect pour lui. » Le projet de Maylis Besserie va toutefois évoluer puisqu’elle décide finalement de se concentrer sur le seul Beckett à l’hospice, dans ses derniers mois, sous la forme d’un monologue intérieur de plus en plus comateux. « C’est gonflé », lui répond et lui répètera souvent Laclavetine, « il n’y aura qu’un seul point de vue. » C’est l’éditeur qui parle et qui voit bien ce qu’il y a de sacrilège à vouloir faire parler un prix Nobel de littérature qui se sera acharné de texte en texte à conduire le langage jusqu’aux portes de silence, à l’innommable.
Pourtant, force est de reconnaître que Maylis Besserie a réussi son impossible pari. Et vite. « J’ai écrit ce livre en quatre mois » nous dit-elle, « en y travaillant jour et nuit ». Beckett parle, et tout beckettien que nous soyons, nous ne sommes pas outrés. Page 64, il donne même l’impression de parler de Maylis Besserie elle-même quand il dit : « C’est son commencement. Moi, j’étais mal parti – mes débuts laissent à désirer. C’est important de bien commencer. »
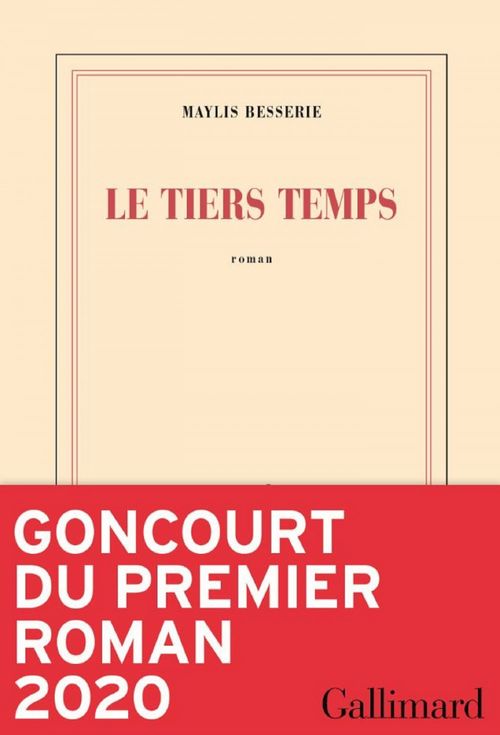
Refs : Maylis Besserie, Le Tiers-temps, Gallimard, 184p., 18€







