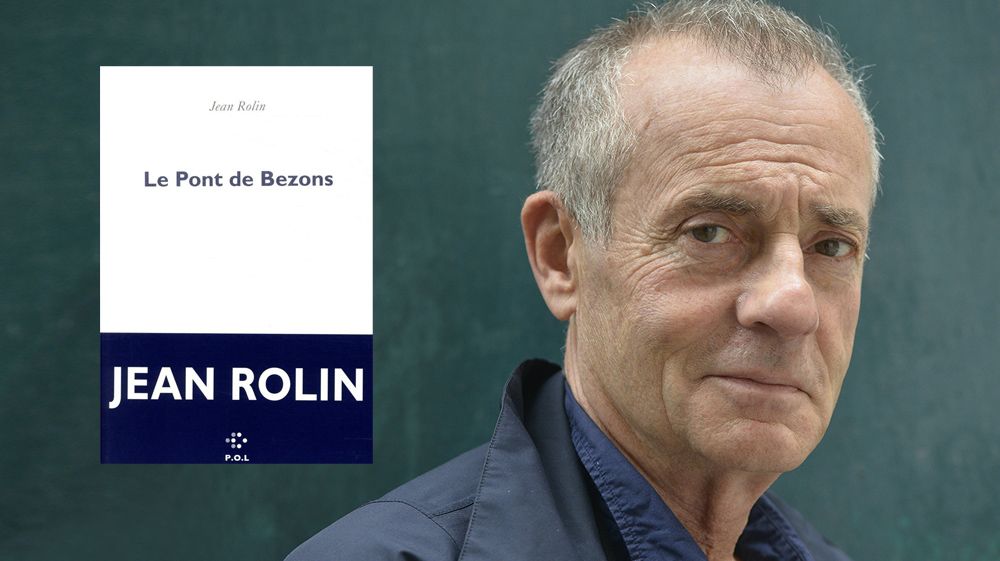À la fois minutieux et ample, Le Pont de Bezons est une brillante balade d’écrivain le long de la Seine.
Qu’elles semblent lointaines – révolues autant que désuètes – les tentatives de plier la littérature à des « lois », d’y discerner des principes physiques ou biologiques d’évolution, de croissance. Mais voilà le nouveau Jean Rolin, carnet de bord d’un arpentage délibérément capricieux des paysages de la Seine, où l’écriture est une branche de la mécanique des fluides.
Remous et reflux : si l’objectif avoué est d’assister à la naissance du jour sur le pont de Bezons, le livre est d’abord la cartographie d’un réseau, celui des trajets de Rolin qui, comme des courants plus ou moins anarchiques, amènent et ramènent l’écrivain sur les sites qui s’égrènent entre Melun et Mantes. Corbeil et son café kurde, le cimetière des chiens d’Asnières où repose le compagnon canin de Houellebecq, les salons de coiffure recensés rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges, les îles, les champs, les chemins, leur faune – carpes, cygnes –, leur flore – clématites et cerisiers… Rolin va, vient et revient, démultipliant les points de vue, empruntant une voie, puis autre, mobile comme un bouchon flottant au gré du vent à la surface d’un étang, tel celui du Giboin, dont le nom pourrait être « celui d’une espèce intermédiaire entre le gibbon et le babouin ».
Car Rolin est sensible aux noms, à ce qu’ils recèlent de suggestion évocatoire, tel ce « M. Loutre » qui, à l’image de son homonyme piscivore, est un fervent de pêche à la carpe. Mais il est tout aussi sensible à la beauté teintée d’insolite que lui, ornithologue autant que lexicophile, peut trouver au « vanneau sociable ». La densité factuelle du Pont de Bezons est aérée par ces jeux poétiques. Car il y a dans la langue de Rolin, dans sa phrase fluviale, qui se segmente et se ramifie en incidentes et en réminiscences, comme autant de biefs ou d’affluents, une tendance à la confluence. La rigueur descriptive, qui pourrait être celle d’une campagne militaire ou d’un précis de géographie s’allie à des notations chromatiques ravivant le souvenir des impressionnistes, se mêle à des jeux discrets, pince-sans-rire, sur les clichés d’expression (un cygne sur son nid pourrait être « en train de couver quelque chose »)… Sans oublier la tentation du romanesque, ce ton mi-figue, mi-raisin, sceptique mais jamais lourdement ironique, qui ouvre le livre sur des horizons qui excèdent la banalité de ces paysages d’Île-de-France. Car, oui, il est question d’« enchantements », de « miracle » même…
Telle est la loi littéraire du Pont de Bezons : l’osmose. Pour apprécier un paysage, et pour l’écrire, il faut, comme disait Gide, être « poreux ». S’imprégner de tout ce qu’il suggère, tout absorber. Et il n’y va pas seulement d’un impératif esthétique ou, plus exactement, cet impératif esthétique est aussi politique : l’Histoire et l’actualité s’infiltrent partout, plus ou moins souterrainement. Ici, ce sont les Kurdes du PKK de Corbeil qui font souffler un vent révolutionnaire. Là, ce sont – leitmotiv presque hallucinatoire qui scande le livre – les camps de Roms, et la façon dont, en bouleversant le sol, en le rendant impraticable, on tente d’empêcher leur installation. Là encore, ce sont des souvenirs familiaux qui remontent, cet oncle qui s’est égaré dans LVF avant de rejoindre les Forces françaises libres. Révolution, engagement et choix d’un camp, statut de ces éternels migrants que sont les Roms : la Seine, chez Rolin, est une eau agitée – brûlante, même.
Jean Rolin, Le Pont de Bezons, P.O.L, 240 p., 19 €