Ce sont des joyaux de l’œuvre de Whistler – des joyaux de la peinture tout court. Et ils sont à Orsay le temps d’une expo…
C’est à petits pas feutrés de révérence, religieusement retenus, que je suis entré dans la salle d’Orsay où voisinent les fleurons de la Frick Collection et trois œuvres du musée parisien. C’est les jambes flageolantes, un voile tiré sur la vue, comme on rentre bouleversé d’avoir vu une bataille.
Non que, comme Mme de Guermantes, qui « en réalité, (…) détestait la peinture d’Elstir » – Elstir à qui Whistler prête, dans le désordre, les lettres de son nom chez Proust – mes pieuses dispositions initiales aient été contrariées par une inimitié avec la manière du peintre, avec cette dévotion exclusive, comme le rappelle Paul Perrin dans son bel essai du catalogue, au développement des propriétés strictement plastiques de la peinture, dévotion qui l’affilie à la tendance aesthetic britannique ou aux positions d’un Gautier sur nos rives de la Manche. Seul le goût faux du paradoxe facile pourrait pousser à faire la fine bouche devant cette extraordinaire Symphonie en gris et vert : l’Océan, où jamais peut-être la dérobade de l’espace dans les lointains, le drame de l’horizon inaccessible, n’ont été représentés de façon aussi singulièrement proche, n’ont fait partie aussi intimement de notre espace de spectateur. Seule une pernicieuse adhésion aux jouissances de la dissonance, de l’hétérogénéité des matières et des formes ferait méconnaître les joies moins tapageuses, mais plus substantielles des gammes de nuances (« arrangement », « symphonie », tels sont les mots prisés par Whistler) déployées pour les altières figures de Frances Leyland, Rosa Corder ou, cerise en gris et noir pour les adeptes de Proust, encore, et de Huysmans, la silhouette de Robert de Montesquiou-Fezensac. Et il n’aurait pas le cœur pictural, pas de cœur tout court, celui qui bâillerait devant la parcimonie chromatique, la contention janséniste de la pose, du portrait de la mère de l’artiste, et il serait indigne de Venise celui qui répudierait les pastels de la Sérénissime où le papier teinté brun met une brume d’or rouillé (si l’or était sujet à la rouille), ou encore celui qui, à ces eaux-fortes dont la recette est héritée de Rembrandt, préférerait une carte postale de la place Saint-Marc.
Alors d’où, en sortant, cet affaissement, cet endolorissement de tout l’être, comme si j’avais été ébranlé par quelque violent phénomène ? Les œuvres sont-elles un peu hantées, et l’esprit d’Henry Clay Frick, collectionneur amoureux de la peinture, mais aussi nabab froid, dur en affaires, dur tout court, se manifesterait-il à travers elles ? Plus sûrement cela tient-il à cette inexprimable brutalité dont tous, êtres et paysages, semblent d’éphémères rescapés. Frances Leyland, « symphonie en chair et rose » selon le titre, mais on dirait aussi bien « symphonie fantastique », ou « fantomatique », tant c’est aussi une ode, ou plutôt une élégie, à la pâleur, ou encore Le Cimetière : Venise, un de ces pastels dont on parlait plus haut comme rongé par l’or (brun) du temps : partout, la peinture se bat avec la mort.
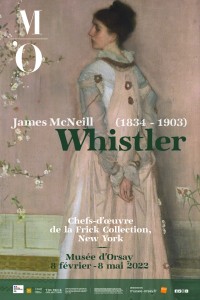
Exposition James McNeill Whistler (1834-1903. Chefs-d’œuvre de la Frick Collection, New York, jusqu’au 8 mai. Informations et réservations en suivant ce lien.
Catalogue James McNeill Whistler (1834-1903). Chefs d’œuvre de la Frick Collection, New York, Musée d’Orsay et de l’Orangerie / Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 160 p., 25€











