La rédactrice en chef de Transfuge, Oriane Jeancourt Galignani, sort son cinquième roman, Quand l’arbre tombe. Un roman tout en pudeur et délicatesse sur la relation entre un père et sa fille, au crépuscule de sa vie.
C’est une histoire d’arbres qui tombent et d’un vieux chêne qui pleure ses congénères. Un vieux chêne entêté se débattant seul, avec des emballements d’ingénieux Hidalgo exalté, pour sauver ce qu’il y a à sauver, et condamner ce qu’il y a à condamner dans le parc aux beautés fanées. Ce vieux chêne est cet homme autrefois impérial dont la parole et les actes ne souffraient aucune contestation. Un pater familias abritant sa petite tribu sous ses frondaisons protectrices, moins rassurantes qu’inquiétantes. Paul est l’un de ces chênes qu’on n’abat pas si aisément. Cet équarrisseur en chef adepte de « la ligne claire », s’attaque aux branches mortes ou estropiées, aux troncs évidés par des colonies d’insectes voraces, comme on range ses dossiers avant l’échéance finale. Paul met en ordre son existence de satrape des affaires en commençant par dresser l’inventaire de ce paysage de fantaisie auquel il a tant donné. Mais voici que débarque Zélie, sa fille, dans cette propriété de Sologne d’où s’échappent des sous-bois humides l’odeur tourbée de l’humus, aux prenantes senteurs de champignons, de mousses, de vers et de putréfaction. L’un et l’autre se ressemblent par leurs petites tailles, leurs petites mains, une catégorie d’êtres « condamnés à charmer pour pouvoir un tant soit peu exister ». Seulement, si « Paul avait voué son existence à « exister », Zélie « avait voué les siennes à éviter l’existence ». Entre la fille et le père, complices méfiants, proches lointains, un fantôme bien présent, celui de Frédéric, le fils écrasé, le frère homosexuel, suicidé, trop fragile pour supporter plus longtemps une existence de raté volontaire. Frédéric, ce musicien cultivé et fin, simple passant de la vie, sans autres attaches que la lecture et la présence de Luc, ce garçon aimé qui veillait sur lui.
À la mort de l’un va survenir la renaissance de l’autre, entré dans les ordres, élisant l’amour du Christ aux dépens de l’amour de son dieu de chair et de larmes. Quinze ans plus tard, le voici de retour ayant quitté la voie divine pour emprunter celle, plus prosaïque, du retour à la vie ordinaire, avec un passage par la maison de son ex-belle famille. Que vient-il faire ? Quel est le sens de ce passage inattendu ? Pour quelles raisons le père, ce beau-père tant haï (et qui le lui rend bien) accepte la présence de l’ennemi ? Sans doute parce que, affaibli, malade, mais lucide, Paul se voit lui-même comme l’un de ses chênes qu’on abat à son tour et accepte le défi comme on accepte une reconnaissance de dette. Il serait bien sûr déraisonnable d’en dire davantage. Il est toujours bon qu’un roman conserve sa part de mystère, ici pourrait-on parler de subtile gradation vers une violence libératoire (le critique n’est là que pour faire les présentations avec toutes les amabilités d’usage lorsqu’il est enthousiaste, comme c’est ici le cas). Dans ce remarquable huis clos en plein air (ou presque) Oriane Jeancourt Galignani mêle à la perfection nature humaine et nature végétale, l’une renvoyant à l’autre dans un merveilleux accord de tons et de couleurs, de calme feutré et de tempête rentrée. Ce court roman d’une femme qui fut ce que sont toutes les filles, celle d’un père, aimé, sondé, bousculé, incompris, et forcément contesté, est une bouffée d’air (en quelque sorte) au milieu de l’atmosphère parfois asphyxiante et claustrophobe, souvent pleine de redites et de laborieux poncifs, de la rentrée littéraire. Derrière la montée en puissance de la tension entre les trois personnages jusqu’à l’explosion libératoire entre père et fille, se lit aussi quelque chose de bien plus insolite, l’interpénétration entre le muet immobile et le loquace agité. L’arbre, c’est bien connu, cache la forêt. Celle des infinies cruautés qu’abrite chaque famille ou presque.
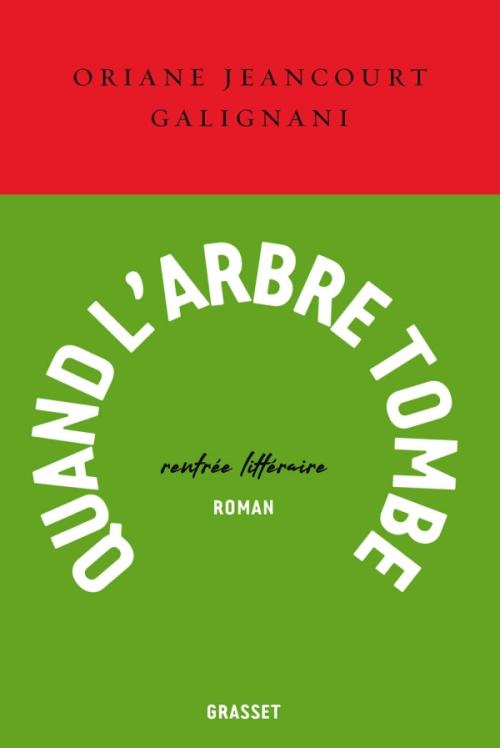
Quand l’arbre tombe, de Oriane Jeancourt Galignani, Grasset, 200 p., 18 €.











