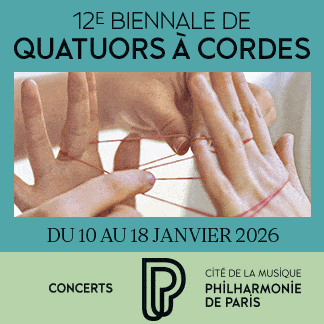Exemplaire dans son information, enchanteresse pour les yeux et sans une once de complaisance : l’expo du quai Branly sur La Nouvelle-Orléans et ses Black Indians est une grande réussite.
Les dehors lissés, polis, blancs, de la notion de pureté ont la perfection froide de gouttes de poison, un poison dont le principe actif se confond avec le racisme. L’exposition n’a cure de pureté, elle qui sollicite toutes les catégories d’objets : une grande toile de Marcel Antoine Verdier de 1843 dont le faire, tout en surfaces et en reflets, instaure un contraste glaçant avec le châtiment infligé à un esclave ; un somptueux costume nommé The Spirit in the Dark, du Big Chief Victor Harris; plus loin encore un costume qu’on dirait volontiers historié si on cherchait l’aride pureté de la langue de l’histoire de l’art, celui du Big Chief des Flaming Arrows, Alfred Doucette. Ce « suit », (et non pas « costume » en anglais, précise Kim Vaz-Deville, co-commissaire) nommé Marie Laveau, dispute sa puissante, transportante simplicité, sa hauteur de sentiment aux plus éloquentes peintures d’Église, exaltant, selon une composition ascendante, Marie Laveau, la plus fameuse prêtresse vaudoue de la Nouvelle-Orléans.
Impureté, mais point imprécision, la profusion de l’expo servant à conforter la fermeté d’accent d’une imparable démonstration. J’allais écrire « imparable rappel », mais « Nous sommes les Etats-Unis de l’amnésie. », souligne, en citant Gore Vidal, le peintre Vincent Valdez, dont la monumentale toile The City I donne aux capuchons du KKK une terreur goyesque qui n’a rien d’une fantasmagorie macabre de la palette, mais témoigne d’une hantise bien réelle et bien présente. Une démonstration chronologique qui suit le cours non pas du Mississippi mais celui, historique, du poison racial en Louisiane et à La Nouvelle-Orléans : période française, commerce triangulaire, lois « Jim Crow », Katrina… Les formes et les symptômes évoluent, l’essence demeure inchangée.
De tels effets ne peuvent être combattus que par le recours à des préparations joyeusement impures, où entrent, dosées avec un soin patient d’artisan et une ferveur toujours renouvelée, la musique, la danse, l’incandescence coloriste – soit toute la pratique esthétique, spirituelle et politique d’une tradition comme celle des Black Indians de La Nouvelle Orléans. Les Big Chiefs, les costumes évoqués plus haut ne sont pas l’émanation pittoresque d’un folklore au sens le plus bafoué et inoffensif du terme, mais l’expression distincte, véhémente et subtile d’un défi retentissant, aussi bien sonore que visuel. Une thérapie par le choc esthétique, où ces tribes, fastueusement costumées, réglées par une précise organisation des rôles, rivalisent de splendeur lors du carnaval, une splendeur dérivée de l’appareil des costumes amérindiens. Car, note Steve Bourget, l’autre commissaire, dans un catalogue qui sera désormais le viatique de tout visiteur de « The Big Easy », qui est bien éloignée d’être si « easy », « l’ « Indian », symbole de puissance, de panache et de résilience, s’impose comme modèle aux Africains-Américains de la période ségrégationniste de la seconde moitié du XIXe siècle. »

Exposition Black Indians de La Nouvelle-Orléans, musée du quai Branly-Jacques Chirac, jusqu’au 15 janvier
Catalogue : Black Indians de La Nouvelle-Orléans, coédition musée du quai Branly-Jacques Chirac / Actes Sud, 224 p., 43€