Faut-il être joueur pour traiter de Las Vegas et du poker dans un roman ? En tout cas, il faut être un écrivain de première force. A l’image de Dario Diofebi, qu’on a rencontré pour l’excellent Paradise, Nevada.
C’est une ville, Las Vegas ; c’est un jeu, le poker ; c’est un de ces romans foisonnants où les trajectoires des uns et des autres – Ray l’ex-joueur en ligne, Tom l’Italien, Mary Ann la serveuse, Lindsay la journaliste –, comme autant de rayons, dessinent, loin de tous les schémas réducteurs, de tous les raccourcis faciles, les complications infinies du plan d’une ville et les mille accidents des existences qui y convergent. Dario Diofebi a l’œil du traqueur, à qui rien n’échappe. Il a aussi l’œil de l’artiste, capable d’assembler une masse apparemment disparate en un objet savamment équilibré, capable d’agencer ce tout proliférant en un ensemble d’une merveilleuse unité. Que gagne-t-on, comment gagner, à tous les sens du terme – économique, moral, psychique ? Tel est le point d’interrogation qui se dessine génialement sur plus de six cents pages. Ce sont de grands mots, tout cela – écoutons plutôt Dario Diofebi : loquace, souriant et précis, il joue franc-jeu.
Les biographies d’écrivains sont souvent vaines, mais pas dans votre cas, puisque vous avez été joueur de poker en ligne et vous êtes installé à Vegas…
C’est exact, mais avant, j’avais déjà fait des études de lettres, aussi j’étais déjà un écrivain, ou un littéraire. Puis, j’ai passé quelques années à jouer avant de postuler à divers programmes de creative writing aux Etats-Unis, et j’ai eu la chance d’être pris à la New York University. Aussitôt, j’ai décidé que j’en avais fini avec le poker, et que je me consacrerai à plein temps à l’écriture.
Ray, le pro du poker en ligne, Tom, originaire comme vous d’Italie, Lindsay, l’écrivaine : autant de facettes de Dario Diofebi ?
A l’évidence, tous les personnages tiennent quelque chose de moi, mais je ne voulais pas que ce roman soit autobiographique. Des aspects de la carrière de Ray sont analogues aux miens, mais il est bien meilleur que je ne l’étais ! Quant à Tom, nos milieux d’origine et nos personnalités diffèrent du tout au tout. Lui a cet optimisme naïf et charmant qu’on aime à trouver dans un roman. En tout cas, moi, j’aime les livres où apparaissent des personnages dépourvus de ce cynisme blasé qui semble venir si naturellement sous la plume des auteurs. Lindsay, enfin, est bien entendu un personnage d’écrivain, comme son frère Orson, qui a en commun avec moi la tendance à l’obsession documentaire. Mais tous les personnages du livre sont des êtres composites, un mélange des histoires que j’ai entendues à Vegas, où on passe son temps à discuter, de quelques-unes de mes propres expériences et d’éléments complètement inventés.
J’ai eu l’impression, à la lecture, que Ray, Lindsay et les autres, pouvaient être des versions différentes d’un même et unique personnage…
Une chose en tout cas les réunit. Ils sont tous à un moment de crise personnelle où ils cherchent quelqu’un qui leur dirait comment mener leur vie, une structure qui donne un sens à celle-ci. C’est quelque chose que j’éprouvais très nettement quand j’avais la vingtaine. Je sais, c’est un cliché de dire que le monde est complexe, mais il y avait tant d’informations, tant de récits qui circulaient et expliquaient ce que c’était qu’être une personne bien, comment il fallait vivre, ce qu’il fallait faire…
Finissons-en avec votre propre biographie. Quand vous êtes arrivé à Vegas, comment avez-vous réagi ?
Ma première impression d’un lieu n’est pas toujours très pénétrante ou très profonde. Lorsque je suis arrivé à Vegas pour la première fois, c’était le jour de l’An, ou presque, il devait être 23h55, et quelqu’un dans le bar d’un hôtel m’a tendu, à minuit, un énorme shot de tequila, en me disant : « Bois ! ». C’était le stéréotype de Vegas et de sa folle vie… Mais je crois qu’il faut y vivre pour se faire une idée de cette ville – c’est vrai de beaucoup de villes, mais de Vegas en particulier : il y a tant d’idée préconçues, fossilisées à son propos, qu’il est vraiment difficile de les dépasser. Si vous ne restez que trois jours, vous serez tributaire de tout ce que vous avez lu et vu, comme Las Vegas Parano, Ocean’s Eleven. Mais si vous y résidez, au bout d’un moment, tout ça se dissipe, l’endroit perd ce qu’il a de remarquable, vous n’y faites plus attention, vous cessez de voir les ivrognes, les lumières…
Ce qui frappe justement dans votre livre, c’est que personne n’est dupe des charmes clinquants de Vegas… Tout est factice, et vos personnages le savent bien.
Je ne voulais pas écrire sur tout ce que Vegas a de fake, du genre, oh, mon Dieu, c’est un endroit où le réel se mêle à l’irréel, je ne voulais pas faire un roman sur ce paradis factice, mais sur une vraie ville avec des gens qui y vivent vraiment. Je suis entré si souvent dans le Bellagio [hôtel-casino dont le modèle est une ville au bord du lac de Côme, ndlr] qu’il a très vite cessé d’être un simulacre d’Italie. On a beau vouloir leur donner une aura poétique, ou philosophique avec de grands concepts, un site n’est qu’un site. C’est la dimension absurde, surprenante, de la beauté de Vegas : si vous y restez un peu longtemps, l’endroit devient normal. Ça, c’est un truc qui me plaît.
On n’associe pas souvent le terme « beauté » à Las Vegas…
D’abord [il rit], j’aime bien les néons ! Et puis il y a une beauté dans cette façon hyper-hyper-capitaliste de rassembler, dans un espace très étroit, tous ces bâtiments extrêmement fonctionnels qui ont pourtant des allures de décors de contes de fées, et que vous ne pouvez pas ne pas voir comme des machines à faire de l’argent. A Paris, à Rome, lorsqu’on contemple une belle architecture, l’argent n’apparaît pas immédiatement comme la première raison pour laquelle elle a été bâtie ; mais devant un casino, à Vegas, aucun doute possible… Mais il y a une espèce de beauté, oui, dans la façon dont chaque casino se presse l’un contre l’autre, surenchérit pour vous inciter à dépenser votre argent chez lui et pas chez la concurrence, il y a quelque chose d’artistique…
Comme une œuvre de pop art ?
Probablement, oui, je crois ! Mais on parle du Strip, là, le reste de Vegas n’a rien de remarquable, la plus grande partie de la ville est tout aussi normale que Phoenix.
Le poker non plus n’a rien de romantique ou de mythique dans le livre… C’est un boulot comme un autre.
Il n’y a que de cette façon que je pouvais écrire sur Vegas. Des critiques ont pu dire qu’il y avait un peu trop de passages dans le livre sur la terminologie du poker, et qu’on aurait pu couper. Je ne crois pas : oui, c’est peut-être banal et ennuyeux, mais on ne peut pas en faire l’économie si on veut montrer ce qu’est vraiment le poker. C’est terriblement ennuyeux ! Et si ce n’est pas ennuyeux, alors il y a un truc qui cloche : les joueurs qui s’excitent, dont le cœur s’affole quand ils ont de bonnes cartes, ne sont pas de bons joueurs. Ils ne restent pas longtemps. Les meilleurs ont quelque chose de robots. Et il est difficile de trouver de bons exemples de romans faisant intervenir le poker, car il est difficile de décrire l’ennui d’une façon agréable à lire. Aussi je n’ai pas voulu me cantonner à Ray, sans quoi personne n’aurait lu le livre !
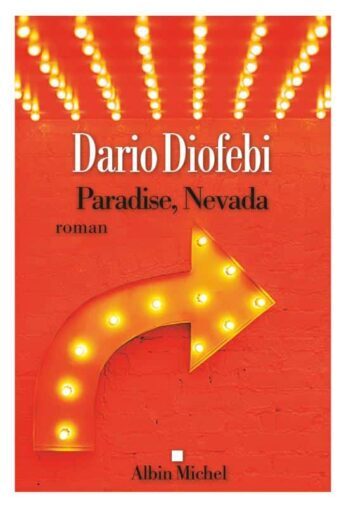
Dario Diofebi, Paradise, Nevada, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Paul Matthieu, Albin Michel, 656 p., 23,90€







