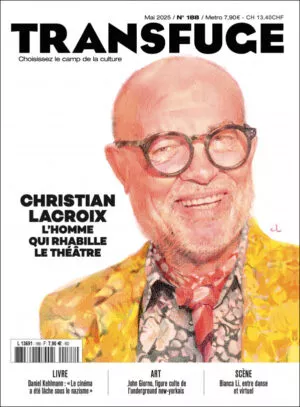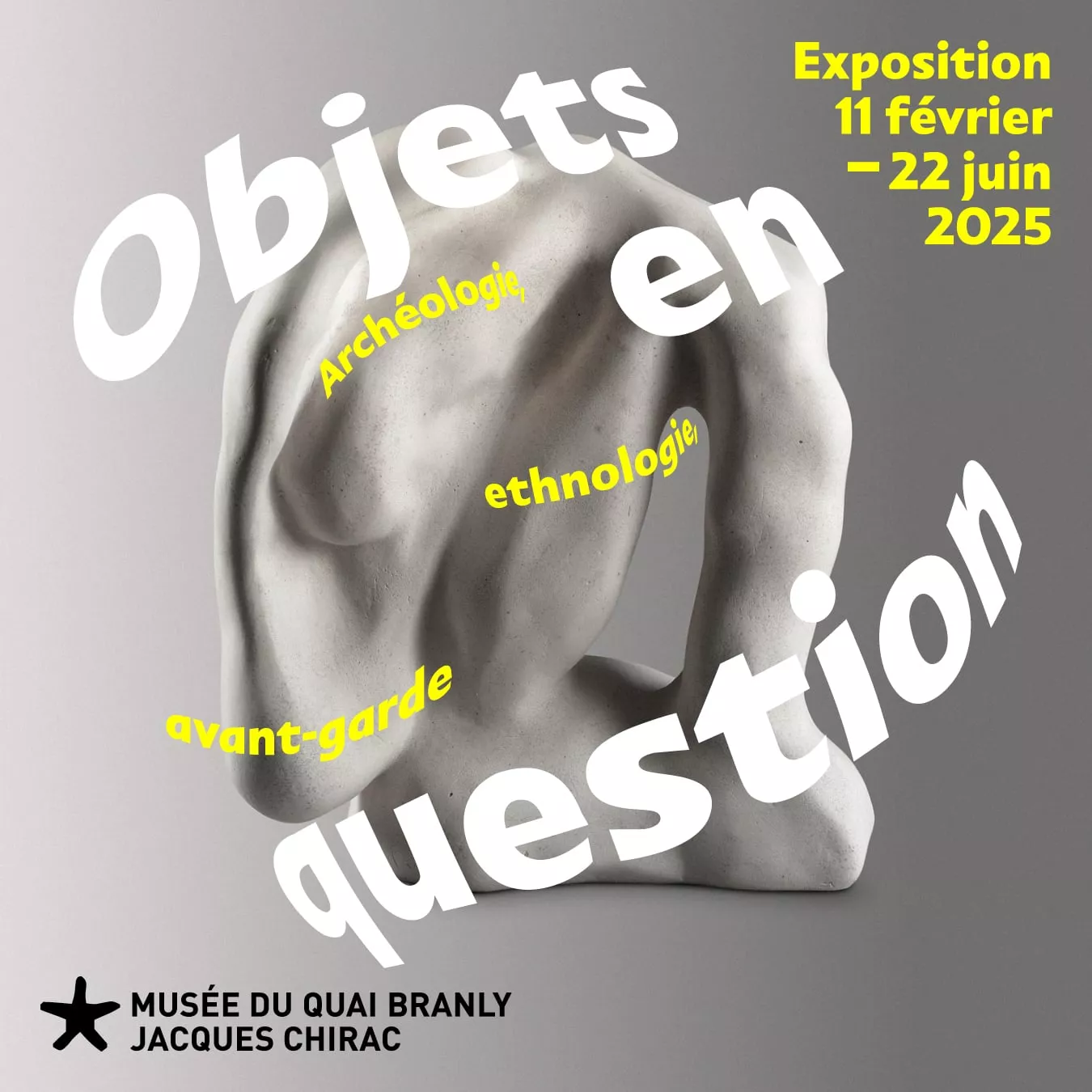Depuis plusieurs mois, MeToo cinéma est partout dans les médias et le débat public. Cette longue séquence a culminé avec la grande photo du Monde et la proposition de loi pour mieux dompter les violeurs, brutes et autres abuseurs. Des lois existent déjà, il suffirait peut-être de les appliquer avec plus de diligence et d’efficacité. Mais au-delà de l’aspiration légitime à réduire les violences faites aux femmes, ce qui nous intéresse ici sous l’intitulé de cette rubrique, c’est l’effet de MeToo sur la critique cinéma. Et là, la vague néo-féministe peut prendre des virages pour le moins discutables.
Dans le « grand quotidien du soir », on a ainsi pu lire que « le cinéma était un endroit de culture du viol » (Iris Brey), que « toutes les femmes, sur l’écran du cinéma qui est la vraie vie agrandie, étaient des survivantes » (Hélène Frappat), ou que « le cinéma doit en finir avec l’exception sexuelle » (Eric Fassin). Dans un mensuel cinéphile qui m’était cher, on a encore lu éberlué Hélène Frappat comparer, à partir du Hantise de George Cukor, « l’expérience du couple hétéronormé » et la Shoah, entre lesquelles il n’y aurait « qu’une différence d’échelle ». Je passe sur les divers mea culpa de la critique, autoflagellation collective du « triangle des Bermudes » qui a du bien faire sourire Michel Ciment là-haut.
Manifestement, il ne s’agit plus seulement de dénoncer les abus de certains mais de mener une offensive générale contre le cinéma – singulièrement contre le cinéma d’auteur, la Nouvelle Vague, la pensée critique issue de l’école Cahiers du Cinéma et plus généralement contre l’ère d’émancipation consécutive à mai 68. L’heure est au déboulonnage de la statue et du statut d’auteur qui seraient des reliques boomer. Si l’on souscrit à la lutte contre les comportements abusifs, on est stupéfait de voir un certain courant radical du féminisme se faire allié objectif de la droite la plus réactionnaire qui a toujours détesté le cinéma d’auteur et l’esprit libertaire de mai 68. On a donc envie de défendre, non pas les abuseurs, mais ce cher cinéma d’auteur voué aux gémonies, comme ont commencé à le faire dans Le Monde le critique Jean Narboni ou la juriste Agnès Tricoire avec des textes aussi mesurés que solidement argumentés.
A celles et ceux qui nous assènent que le cinéma a représenté les femmes comme des potiches ou des victimes, je répondrais que la majorité des grands films et des grands cinéastes masculins ou féminins (Cukor, Hawks, Renoir, Rossellini, Varda, Akerman, Antonioni, Demy, Bergman, Rohmer, Rivette, Bigelow, Denis, Fassbinder, Almodovar, Mazuy, Triet, Llinas, Citarella… liste non exhaustive) ont surtout montré des femmes complexes, indépendantes et agissantes. Il serait d’ailleurs surréaliste de faire croire que les Marlene Dietrich, Katerine Hepburn, Anna Magnani, Liv Ullman, Delphine Seyrig, Catherine Deneuve, Bulle Ogier, Cate Blanchett, Léa Seydoux et des centaines d’autres n’auraient joué (ou n’auraient été) que des femmes passives, des « survivantes » ou des idiotes utiles du patriarcat.
Iris Brey estime qu’en filmant des viols, le cinéma construit la « culture du viol ». Voilà une assertion aussi erronée qu’affirmer que La Liste de Schindler construirait la culture de l’antisémitisme, que Le Parrain formerait des mafieux ou que Tueurs nés serait responsable de la délinquance (ça, la droite l’avait en effet affirmé à l’époque et c’était très con). Représenter ou regarder le mal ne signifie aucunement l’approuver, cela revêt une fonction cathartique et morale, comme les Grecs l’ont établi il y a 2400 ans : plus il y a des horreurs sur la scène (ou l’écran) d’une représentation, moins il y en a dans la vie réelle. Ou comme écrivait Serge Daney, moins il y a de cinéma, plus il y a de fascisme. Quant aux hypothèses théoriques ultra point Godwin d’Hélène Frappat, comment dire ? Je suis heureux que de réelles survivantes comme Simone Veil ou Marceline Loridan, qui ont vécu en « couple hétéronormé » après leur retour des camps, ne soient plus de ce monde pour lire des trucs aussi obscènes. Le lien entre la Shoah et le « couple hétéronormé » ? La première a détruit des millions des seconds (dont mes grands-parents paternels) qui vivaient paisiblement avant Hitler. Alors merci d’arrêter d’instrumentaliser la Shoah à propos de tout et n’importe quoi !
Terminons par la défense de la critique. De quoi devrait-elle s’excuser ? ! D’avoir toujours défendu une idée ambitieuse et exigeante du cinéma et de la presse culturelle ? Notre rôle de critique consiste à analyser les films, à questionner celles et ceux qui les font (sur leur travail, pas sur leur vie privée). Que l’on combatte les abus, que les femmes tiennent toute leur place dans un cinéma qui a longtemps été trop masculin, c’est une évidence, mais jeter la suspicion sur tout un art pour les agissements de quelques-uns, c’est une dérive qu’il faut refuser. De même qu’il ne faut pas confondre ce qui se passe dans le réel et ce qui advient sur un écran : un fantasme n’est pas un passage à l’acte. Une fiction n’est pas le réel. Un film n’est coupable de rien (si ce n’est d’être mauvais). Protégeons le distingo nécessaire entre le mystère des œuvres et la biographie de leurs auteurs : je est un autre ! Éternellement pour Proust et contre Sainte-Beuve !
Le cinéma ne m’a jamais appris à violer, il m’a éduqué, et à l’instar de ce que montre Arnaud Desplechin dans son beau Spectateurs !, il m’a enseigné mille choses sur moi et sur le monde. Honneur donc au cinéma d’auteur et à la critique cinéphile, car bien davantage qu’un lieu de “culture du viol”, le cinéma est un lieu de culture, de rêverie et d’apprentissage.