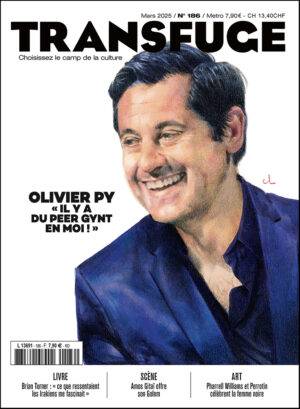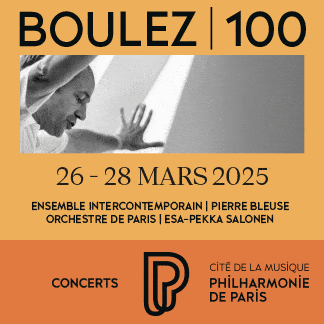C’est une œuvre trop rare que cette Vestale de Spontini qui se donne aujourd’hui à l’opéra Bastille, dans la mise en scène frappante de Lydia Steier.
Elles sont toujours passionnantes, ces œuvres qu’on dit « de transition ». Des pièces pivot, qui permettent le tuilage entre des périodes et des mouvements, et sans qui les cadets n’auraient pas compris (ni aimé) les aînés. Des œuvres qui sont avant tout des traits d’union, des mains tendues.
Il y a de cela dans cette Vestale, succès colossal à sa création le 15 décembre 1807, et qui illustre les fastes impériaux et néoclassiques des âges napoléoniens. Le règne du petit Corse est alors à son apogée et l’opéra de Gaspare Spontini incarne le parangon d’une esthétique à la fois boursouflée et sincère, kitsch et prenante.
Passé entre les mains de Méhul puis Boieldieu, le livret d’Etienne de Jouy inspire aussitôt le musicien italien, qui se sent chez lui dans cet empire romain fantasmé : l’amour impossible d’une vestale pour un officier annonce déjà Norma de Bellini, mais nous sommes avant le Bel canto. Et c’est en cela que La Vestale est intéressante. On est véritablement au gué entre les derniers feux de l’opéra royal d’ancien régime et la révolution esthétique de l’opéra romantique. Pour faire simple : Spontini est fils de Gluck mais père de Berlioz et de tout ce que le grand opéra accouchera vingt ans plus tard : Rossini, Meyerbeer, Halévy, mais également Wagner. Le personnage de Julia, la Vestale, exige d’ailleurs une soprano dramatique dont les accents, l’intensité, sont déjà les prémices d’Élisabeth de Tannhäuser et Elsa de Lohengrin. Bref : l’importance historique et esthétique de cet opéra est incontestable.
Il s’agit ensuite de savoir si son oubli pendant tant d’années est compréhensible. Oui et non. Œuvre lourde, qui demande des voix d’acier, La Vestale possède les défauts des périodes qu’elle clôt et qu’elle annonce : la rigidité de la tragédie lyrique et la pompe du grand opéra. Intrigue convenue, livret en alexandrins de mirlitons, âme martiale : la partition n’évite pas les tunnels. Mais pour le seul deuxième acte, où se noue l’action et où les personnages ouvrent leur cœur, la Vestale doit être connue. Et l’on comprend pourquoi Maria Callas en avait fait un rôle fétiche, dans la production de Visconti en 1954.
À Bastille, sous la baguette attentive et subtile de Bertrand de Billy, Elza van den Heever campe une Julia engagée et intense. La voix est superbe mais sans-doute lui manque-t-il l’aura mystique et suicidaire d’une tragédienne pour vraiment nous convaincre. Sa Julia est presque trop propre : on lui voudrait des brisures. Face à elle, le Licinius de Michael Spyres est -comme toujours- magnifique. Quelques mois après son Lohengrin alsacien, le ténor américain prouve qu’il peut aborder sans crainte (et sans abdiquer sa musicalité, son incroyable agilité vocale) les rôles les plus lourds de sa tessiture. L’ensemble de la distribution est impeccable : le Cinna de Julien Behr, la grande vestale de Eve-Maud Hubeaux, le superbe pontife de Jean Teitgen.
Reste la mise en scène de Lydia Steier. L’Américaine aime le sang, le sexe et la violence : elle nous l’a prouvé dans une Salomé partouzo-viandarde, plutôt efficace. Elle rempile ici, avec un catalogue -assez convenu- de sévices. Dans une atmosphère à mi-chemin entre la Servante écarlate (pour les costumes, ouvertement plagiés) et le décor du grand amphi de la Sorbonne (avec les fresques de Puvis de Chavannes) nous voilà sous une énième dictature militaire. Sous couvert de dénoncer les hystéries religieuses, Lydia Steier réalise malgré tout un livre d’image assez pompier, mais qui s’accorde bien avec l’œuvre. La coda du spectacle, avec rafale de mitraillettes et citation de Voltaire, est bien balourde et s’est vue copieusement huée. Mais malgré ses bonnes intentions, le spectacle remplit son office. Et puis La Vestale est trop rare pour qu’on en fasse l’économie.
La Vestale, de Gaspare Spontini, direction musicale Bertrand de Billy, mise en scène Lydia Steier, Opéra de Paris, jusqu’au 11 juillet