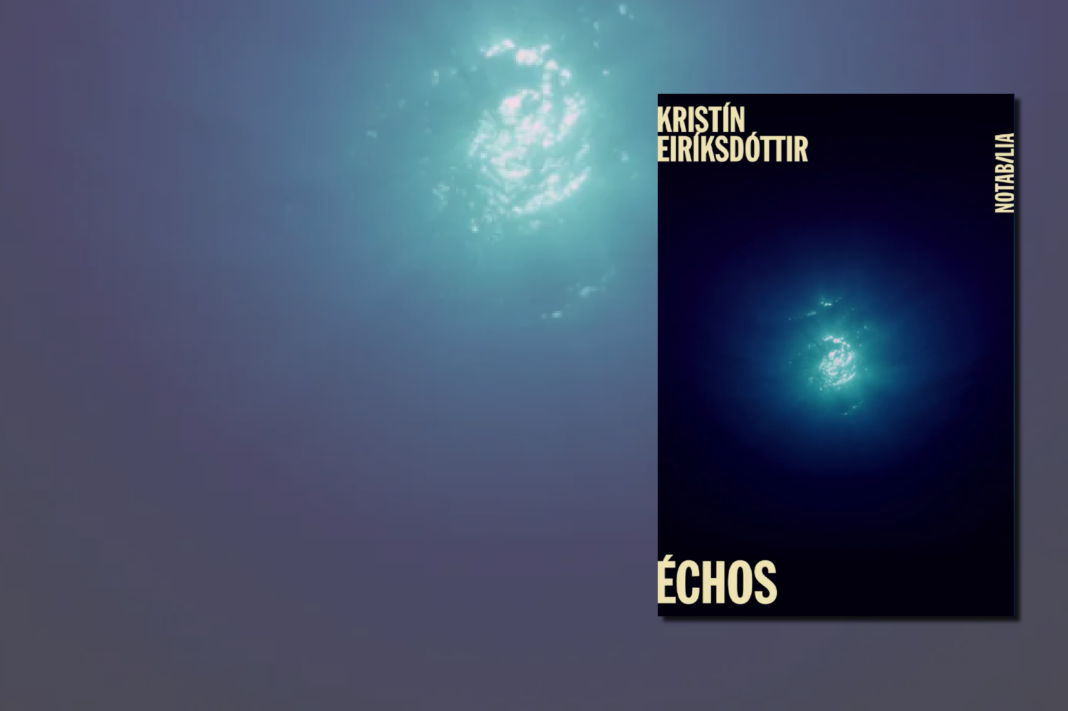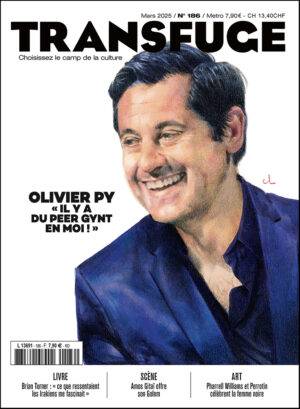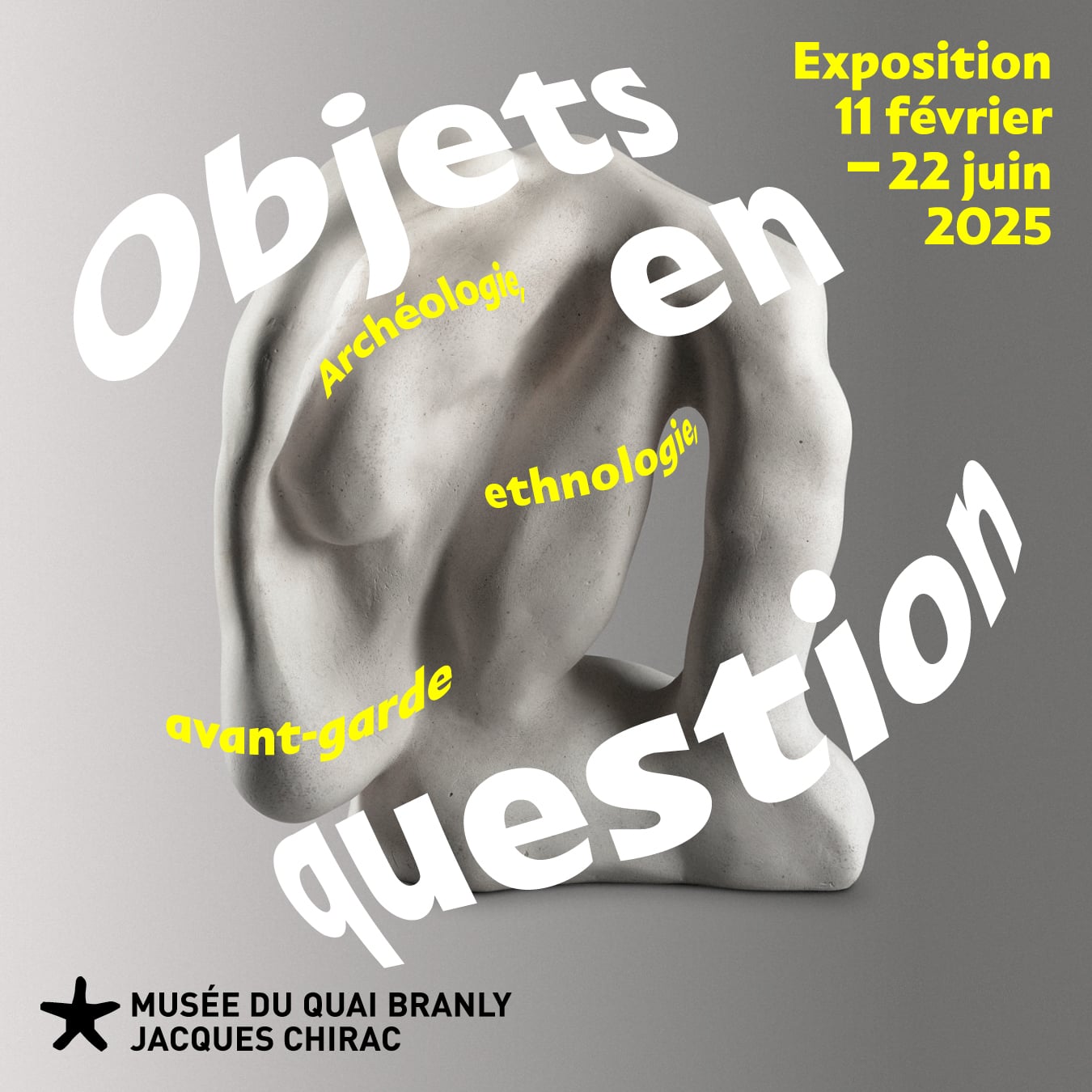On savait l’Islandaise Kristín Eiríksdóttir supérieurement douée. Son dernier roman confirme qu’elle a sa place dans le peloton de tête de la littérature contemporaine européenne.
On se gardera bien de sortir de ses tiroirs l’argenterie ternie des ustensiles traditionnels du chroniqueur flemmard. Ne serait-ce que parce que, dans le nouveau Kristín Eiríksdóttir, le romanesque pur est additionné d’un salutaire trait d’intelligence critique, l’Islandaise étant aussi à l’aise pour poser les termes de débats intellectuels et moraux que pour consigner les vicissitudes des existences qu’elle met en scène.
On laissera donc de côté la vieille lune du « roman choral ». Même si la distribution des parties constitutives du livre (conçu selon le modèle de la boucle, du passage de relais et des parallélismes) fait se succéder les perspectives des protagonistes. En l’espèce, Villa, réalisatrice, auteur d’un film sur Dimitri, un de ces petits voyous au magnétisme noir et à l’espérance de vie sérieusement compromise, espèce de version sordide et sans œuvre (taule, violence, maquereautage, il est aussi junkie) de Rimbaud ou de Jim Morrison ; Jón Logi, antithèse de « Dimmi », père plus que certain de Haki, le fils de Villa ; Ninja, qui a prêté main forte à Villa pour son film ; et Villa, enfin et à nouveau, dont le retour au premier plan clôt cette ronde aussi acrobatique que fluide. Et qui tient bien moins du « chœur » que de la prolifération des scènes, de la volonté d’épuisement (« il faut faire la lumière sur tout », dira Ninja).
On évitera aussi de sortir de la naphtaline l’archaïque niaiserie du « roman sur ». Certes, des « sujets », il y en a, et à foison ici. De la chasse à la baleine (Dimitri bosse sur un baleinier), à l’addiction (alcool, désintoxication sont les formes les plus sensibles du double leitmotiv de la perdition et du salut), en passant par les modalités et les ravages de la domination masculine, les différents avatars de la maternité, l’exercice de la paternité, sans oublier des questions touchant aux confins de l’éthique et de l’esthétique (il faudrait parler ici plus au long de la géniale première partie, où Kristín Eiríksdóttir transforme le débat post-projection du film de Villa en structure narrative aussi souple que ferme). Oh, bien sûr, le lecteur ne s’en fiche pas de cette grave matière – mais comme elle pèse peu rapportée à ce que j’appellerai le « courant humain » !
Le « courant humain », kesaco ? se demande, légitimement inquiet, ledit lecteur qui se dit que ce n’était peut-être pas la peine de congédier les clichés de la critique pour les remplacer par cette formule sibylline. Mais il suffit de lire quelques pages d’Echos et mon image s’élucide d’elle-même. Ce ne sont, en fin de compte, ni les personnages, ni les interrogations éthiques que suscitent leurs destinées qui intéressent Kristín Eiríksdóttir. Mais la circulation d’une histoire à l’autre ; l’incessant glissement du passé au présent ; les collisions, croisements, éloignements, attractions. S’il y a entre deux êtres « tout un monde imaginaire, rempli de quelque chose que ni l’un ni l’autre ne [connaît] », alors peut-être revient-il au roman de rétablir le courant qui relie l’un à l’autre.
Kristín Eiríksdóttir, Echos, traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Notabilia, 432 p., 25€