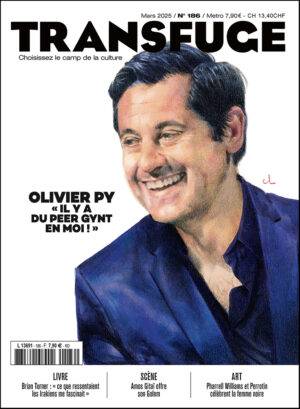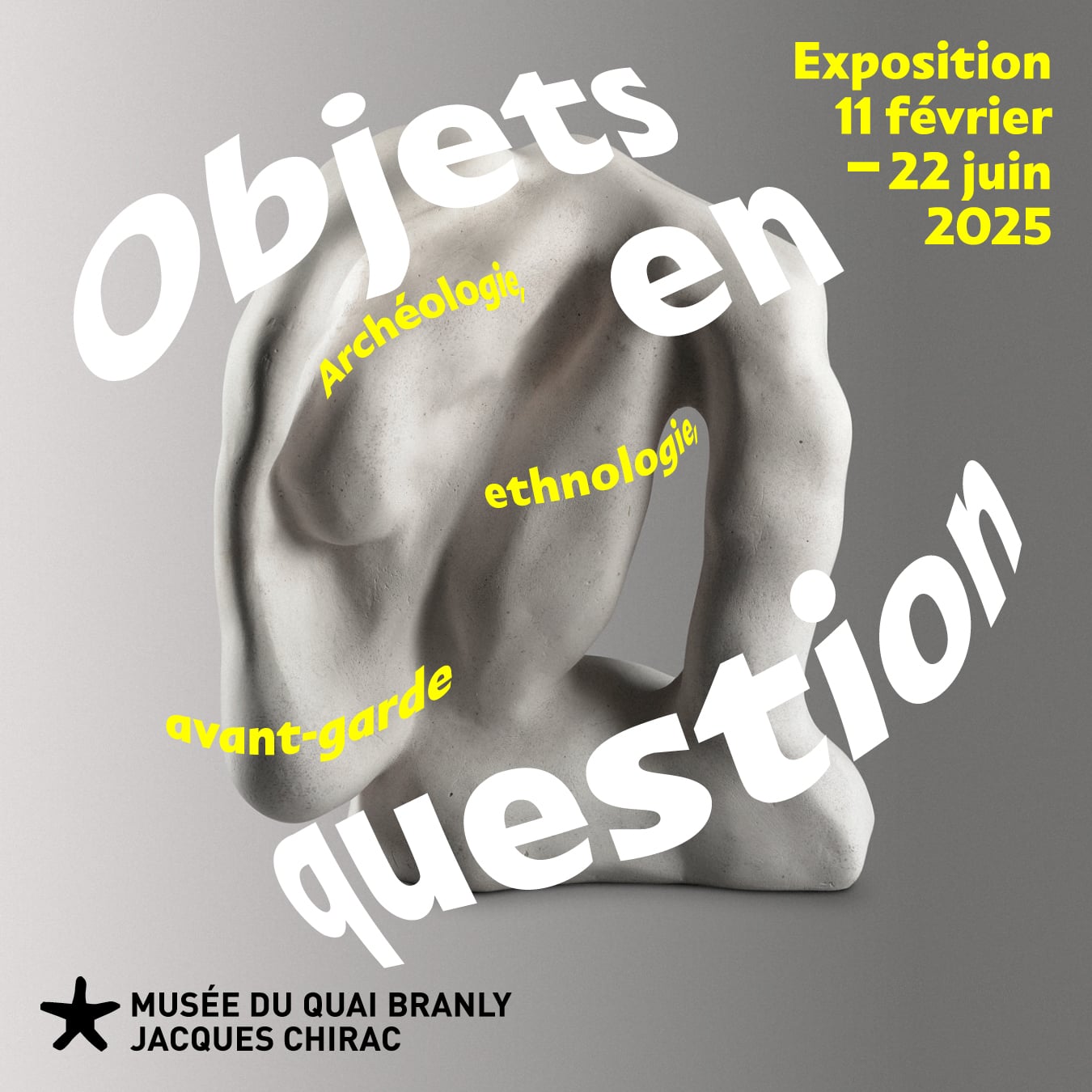Le Café Léa est situé dans le 5ème, ce bel endormi parisien chez lequel il m’arrive si rarement d’aller parce que la ville est séparée par un Mur de Berlin liquide qui s’appelle la Seine. Habiter la fourmillante et coruscante rive Droite implique, pour en franchir la frontière invisible avec l’autre bord, un laisser-passer mental parfois difficile à obtenir de soi-même. Soudain, sur place, tout un monde surgit dont j’avais oublié l’existence, celui des cafés d’étudiants, des premières amours, des après-midi d’hiver à refaire le monde, serrés en bandes sur quelques banquettes en moleskine. Le Café Léa joua ce rôle – pas si lointain – dans l’existence de la romancière Diana Filippova. Qui est Diana Filippova ? Je répète à l’envi ce patronyme parce qu’il sonne si bien. Diana Filippova est une âme sincère et rieuse abritée dans un corps de sexe féminin que je mets quelques secondes à reconnaître dans l’assemblée pléthorique du Café Léa. Que font ces gens de tout âge à picoler et blablater en ce milieu d’après-midi ? Travaillent-ils ? À leur façon, sans doute, à refaire le monde sûrement. Un monde dans lequel on n’aurait plus de besoin de travailler. Une jeune femme brune me fait signe. Est-ce elle, la jolie blonde visible sur le net ? Oui, c’est bien elle. Diana est redevenue Filippova, une Russe d’ascendance grecque aux cheveux aussi noirs que les olives de Kalamata.
A chaque rendez-vous pour cette chronique, où le sort heureux veut que je rencontre plutôt des femmes, je me fais l’effet d’un membre de Tinder, quelque peu balbutiant et intimidé devant une belle inconnue. Le matchmaking est Dieu Merci, sans enjeu ici ou alors : vendre son livre. Mais non, ce serait trop simple. Diana Filippova n’a rien à vendre, puisque j’ai déjà « acheté » son étonnant roman lu et approuvé, l’histoire d’Emmanuelle Borgia, redoutable chroniqueuse judiciaire investie corps et âme dans le procès d’un jeune assassin à l’âme sombre et désenchantée d’un Raskolnikov savoyard. Emmanuelle Borgia mène l’enquête en se plongeant dans les secrets des proches du jeune homme qui vont la faire se confronter par ricochets à ses propres fantômes familiaux, passés et présents. D’un milieu modeste, la jeune femme est mariée à une brillante énarque issue d’un milieu bourgeois conservateur. Cette dernière la renvoie plus ou moins implicitement à ses origines quand cela lui est nécessaire, recréant en cela des schémas de domination identiques à ceux que connaissent les couples hétérosexuels. Enceinte et peu certaine de vouloir le rester, Emmanuelle Borgia est « dans cette espèce d’obligation de polyphonie intérieure pour avancer et trouver sa place », comme le résume l’auteure. Le roman, habilement constitué de plusieurs strates, permet d’aborder les thèmes très contemporains des rapports de classe insidieux, de la place des lesbiennes dans la société et enfin d’évoquer avec force la question de la grossesse désirée ou non, selon les aléas sentimentaux de couple.
Longtemps engagée en politique auprès de Raphaël Glucksmann dans le mouvement Place Publique, puis auprès d’Anne Hidalgo, la jeune femme a définitivement rompu avec le militantisme pour se consacrer à l’écriture. Un nouvel engagement risqué, qui réussit plutôt à cette boulimique de lectures. « La politique, me dit-elle, fonctionne uniquement avec des objectifs à très court terme. Le fait d’être dans l’immédiateté permanente obère toute perspective de changements dans la société. Le triomphe de la communication politique met désormais de côté les personnes les plus profondes, les plus réfléchies, pour valoriser celles surfant sur une émotion de façade très superficielle. Le roman, lui, ouvre des perspectives inexploitées en politique aujourd’hui. Sa capacité à transformer nos imaginaires reste un immense avantage sur la politique ». Ainsi parlait Diana Filippova. Vive le roman donc ! Nous votons pour.
Rien n’est plus grand que la mère des hommes, éditions Albin Michel, 298pages,20,90 euros.
Photo Édouard Monfrais-Albertini