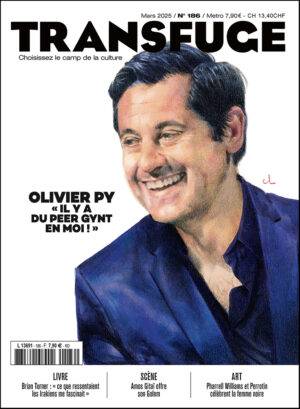Le metteur en scène Arthur Nauzyciel et les acteurs de l’American Repertory Theater de Boston reprennent leur chef-d’œuvre Julius Caesar de Shakespeare, crée il y a 17 ans. La pièce n’a jamais hélas semblé si en phase avec la réalité politique. Rencontre avec Arthur Nauzyciel, au TNB qu’il dirige à Rennes, pour revenir sur cette puissante aventure franco-américaine.
Ils sont huit. Huit hommes en costumes noirs qui arpentent la scène, et tournent autour de leur future victime, en nuée de corbeaux prêts à fondre sur leur proie. Les portraits de Jules César occupent déjà l’espace, alors même qu’il n’est pas encore mort. Ils sont huit à croire qu’ils vont éliminer le héros de Rome aux prétentions monarchiques, ignorant qu’ils vont lui offrir la postérité ultime. Les conspirateurs remuent dans l’ombre puis peu à peu se découpent dans la lumière de leur crime. Julius Caesar est la pièce qui mène de la parole à l’acte. Du poison que l’on verse dans l’oreille, me dira Arthur Nauzyciel au cours de notre entretien, à l’épée qui plonge dans le corps du héros romain, au Sénat. Le personnage central, Brutus, apparaît ici faible, oscillant, dépossédé de lui-même, presque enfantin. Nous sommes loin de l’ambitieux incarné par James Mason dans le Jules César de Mankiewicz. Brutus, dans cette mise en scène de Nauzyciel et magnifiquement interprété par l’acteur américain Neil Patrick Stewart ce soir où nous le découvrons au TNB de Rennes, s’avère celui autour de qui l’on se retrouve, mais qui se laisse guider par Cassius, qui, frère shakespearien du Iago d’Othello, va le mener au pire. Mark Montgomery, de sa haute stature fiévreuse, incarne Cassius au mieux, devenant, dans l’ombre, le deuxième rôle de la pièce, à l’égal de Marc-Antoine, l’autre tribun à qui Daniel Pettrow offre une séduction politique très contemporaine.
Car le sujet de Shakespeare est celui-là, la parole, le discours. Le conspirateur est avant tout celui qui s’unit avec l’autre, pour agir, et ce lien se forge dans la parole. Si Jules César est une pièce d’hommes, elle l’est aussi dans la séduction qui s’exerce entre eux et du lien profond, plus fort que celui du couple, qui unit ceux qui ont fait couler le même sang. Il suffit de voir la dernière scène entre Cassius et Brutus pour le saisir : le meurtre scelle entre ses protagonistes un pacte viscéral : C’est aussi Macbeth qu’annonce Jules Caesar.
C’est là toute l’intuition qui a mené Arthur Nauzyciel à penser et monter, en 2008, à Boston, à l’American Repertory Theater, théâtre soutenu par Harvard qui offrait alors un espace pour les créations théâtrales exigeantes, Julius Caesar. Le jeune metteur en scène français proposait alors aux comédiens américains une nouvelle lecture d’une pièce culte aux États-Unis, notamment grâce au film de Mankiewicz, porté par Marlon Brandon et James Mason. Il proposa une lecture qui n’en ferait pas une pièce d’affrontements de grands hommes et d’hubris, mais une fable presque surnaturelle sur les flottements d’un homme, Brutus, qui finit par devenir qui il est, en tuant Jules César. La scène du meurtre de César mérite à elle seule de voir ce spectacle : ballet fascinant, pensé avec le chorégraphe Damien Jalet, des hommes-corbeaux qui s’acharnent, dans un rythme lent, étudié, sur le corps de César, et s’imprègnent de son sang, en une cérémonie aussi tribale que spectaculaire. Lorsque les meurtriers quittent le Sénat, César se relève, fait face au public, et pousse un cri de guerre. Tout est dit de l’archaïsme politique mais aussi de la vision surréelle que le metteur en scène choisit de nous faire vivre : ce cauchemar d’hommes qui s’acharnent à en tuer un autre, prétextant sauver la République, mais n’accomplissant qu’un sacrifice de plus dans un univers dominé par l’obscurité. Bien sûr, voir cette pièce portée par ces extraordinaires comédiens américains, et quelques-uns des mêmes qu’en 2008, alors que Trump s’apprête à reprendre le pouvoir aux États-Unis, crée un sentiment troublant. Comme s’il fallait revenir à la genèse de la violence politique pour saisir celle qui domine la démocratie américaine. Enfin, c’est de cela, et surtout de théâtre, dont nous parlons avec Arthur Nauzyciel, ce matin brumeux à Rennes.
Exergue 2 : « Chez les acteurs américains, le cérébral ne prend jamais le pas sur le corps. »
Exergue 3 : « Au départ, Jules César devait être un avertissement, c’est devenu une réalité ».
Exergue 4 : « J’ai voulu un Brutus mélancolique ».
Exergue 5 : « L’histoire intime du spectacle est d’avoir été créé lors de l’avènement d’Obama, et de revenir aujourd’hui avec Trump. »
Propos recueillis par Oriane Jeancourt Galignani
Il est frappant de retrouver ce spectacle, avec une distribution très proche de celle de sa création, dix-sept ans après sa première à Boston. Comment ressentez-vous cette renaissance de Julius Caesar ?
Oui, l’un d’eux, Jared Craig, qui incarne Lucius, avait 23 ans à la création, il en a aujourd’hui 40, c’est frappant comme le temps l’a transformé, et l’a mené à une autre forme de jeu. Certains acteurs, présents dans la pièce, je les ai transformés il y a 25 ans, lorsque je créais mon premier spectacle aux États-Unis, Combat de nègres et de chiens, à Atlanta. Jules César a été mon quatrième spectacle américain, j’avais fait des auditions, retrouvé d’autres acteurs, et au fur et à mesure du temps, j’ai rencontré d’autres acteurs américains que j’ai rencontrés lors de la création de Splendid’s en 2015. Pour moi, c’est un spectacle matriciel, j’y ai rencontré Riccardo Hernandez et Scott Zielinski, qui ont fait le décor et les lumières, et avec qui j’ai fait toutes mes créations ensuite. Et puis Damien Jalet, avec qui je vais collaborer ensuite pour la chorégraphie de tous mes spectacles, dont le dernier, Les Paravents.
La présence des corps est frappante dans cette pièce, en effet, comme elle le sera ensuite dans beaucoup de vos productions…
Oui, c’est venu en travaillant sur Koltès, j’ai voulu apporter une dimension musicale et sensuelle à l’approche formelle habituelle. Les Américains, par leur formation et leur manière d’envisager leur métier, font confiance à tous les outils à leur disposition pour pratiquer leur jeu. En France, on se méfie de la notion de méthode ou de processus, alors qu’aux États-Unis, on se remet beaucoup à ça, et donc de ne pas hiérarchiser les différentes pratiques qui vont enrichir le travail d’acteur : la danse, le chant, la musique. En France, on accorde la priorité à « l’interprétation », or les Américains prennent en charge la question du corps avec le même enthousiasme, que pour le travail d’interprétation. Avec les Américains, le cérébral ne prend jamais le pas sur le corps. Ni l’ego. L’acteur ne se sent jamais dépositaire de son rôle : un exemple, un de nos acteurs, Niel, est tombé malade, et en deux jours, un autre acteur de la pièce a repris le rôle, sans problème. Il s’est placé dans les traces de l’acteur précédent, et cela ne posait de problème à personne. C’est aussi ce qui explique la longévité de cette mise en scène, il y a eu souvent des remplacements, formés par d’anciens acteurs de la pièce. Les acteurs américains savent se rendre très disponibles aux propositions qu’on leur fait. Mais c’est aussi le résultat d’un système très peu bénéfique aux acteurs aux États-Unis : le système théâtral américain est fondé sur une très grande concurrence, d’excellentes formations, mais qui offre très peu de propositions…C’est très difficile de gagner sa vie dans le théâtre aux États-Unis. Il n’y a pas de théâtre subventionné là-bas : l’économie du théâtre y est très difficile, sans beaucoup de répétitions, mais avec un long temps d’exploitation. Ça veut dire que si le spectacle marche, et qu’il va à New York, les acteurs vont être remplacés par des acteurs avec un nom. Ce principe de l’offre et de la demande oblige les acteurs à être particulièrement athlétiques. Je suis conscient donc d’avoir bénéficié avec ces acteurs d’un système peu recommandable qui laisse très peu de place au théâtre d’art. Voilà aussi pourquoi nos acteurs sont si engagés, ils ont très peu l’occasion de participer à une aventure exigeante et artistique. D’autant plus qu’il s’agit d’une pièce qui raconte un danger politique à venir, qui est devenu leur présent. Ce qui les bouleverse. Il y a quelques années, on se disait que ce spectacle agirait comme un avertissement, aujourd’hui, il chronique une réalité. C’est inouï de se dire que cette chose qui nous vient du XVIe siècle est en train de nous rattraper. Voilà aussi ce qui nous pousse à le jouer aujourd’hui. Ce n’est pas que j’ai envie de répondre à l’actualité, mais ce texte, ce spectacle s’est imposé comme quelque chose de nécessaire. C’est un spectacle qui au-delà de toute morale, de toute velléité de donner une leçon, nous renvoie profondément aux questions qui nous traversent : le pouvoir, la démocratie, le collectif, le libre arbitre, nos désillusions, nos utopies…
C’est frappant comme dans votre spectacle on entend le texte shakespearien de manière profonde, notamment l’humour. Comment êtes-vous parvenus, avec les acteurs, à une telle approche de la langue shakespearienne ?
Je travaille toujours à partir des acteurs, plutôt qu’à partir des personnages : or, là , ce sont des acteurs extrêmement intelligents, humbles, et très drôles. C’est vrai que le texte fait part d’humour, c’est-à-dire de nuances, et ça c’est eux qui me l’ont fait découvrir, ensuite je leur ai fait des propositions qui leur ont plu. Le fait est qu’il y a de nombreux registres dans cette pièce, l’humour, le tragique, mais aussi le drame, l’épique ou la pure rhétorique politique. Et le surnaturel : les gens lisent à la lumière des météorites en feu, dans un monde où les fantômes apparaissent. La pièce a lieu entre rêve et sommeil, quasiment tous les actes commencent et se terminent par la question, « est-ce que tu dors ? », ou « Brutus, réveille-toi ! », comme si cette pièce était un mauvais rêve, et Brutus, un somnambule qui naviguerait entre plusieurs dimensions. C’est là la force de la pièce, sa capacité à se métamorphoser. Je crois aussi que la dimension surnaturelle permet au théâtre d’advenir, et de ne pas être seulement démonstratif. La dimension métaphysique est au cœur de la pièce : Brutus dit qu’il est en guerre avec lui-même, dès le départ il considère la mort et la vie de la même façon. Il s’est perdu de vue, ce à quoi Cassius répond, « à partir de maintenant, je vais être votre miroir ». Et Brutus de répondre, « dans quel danger allez-vous me précipiter, vous qui voyez en moi des choses que je ne sais pas ? ». C’est extraordinaire de commencer une pièce là-dessus : tout le rapport des deux hommes va être fondé sur ce contrat-là, l’un révèle à l’autre qui il est. L’expérience du meurtre de César étant l’apogée de cette révélation : à partir de là, Brutus se sent vivant. Plane aussi l’idée que l’action va inventer l’homme, et qu’il est donc fort de son libre arbitre, idée très révolutionnaire sous le règne élisabéthain, époque très religieuse…
Dans quelle mesure vous inscrivez-vous à l’encontre de la vision habituelle de la pièce aux Etats-Unis, véhiculée notamment par le film de Mankiewicz ?
Oui, les acteurs ont été remarquables de mettre de côté de leurs références sur la pièce, pour accepter que quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas les emmène ailleurs que là où d’habitude on travaille Jules César. Et même si j’ai su après qu’ils ont eu des grands moments de doute, ils ont eu l’élégance de ne jamais le montrer.
Enfin, même si j’ai voulu faire voir la dimension surnaturelle que nous évoquions, j’ai aussi voulu garder la dimension politique qui est absolument fascinante, notamment dans la façon de Shakespeare d’appréhender la manipulation des masses, la capacité du langage à construire, et à détruire le monde. C’est bien ce que l’on vit aujourd’hui : quelques mots sur une plateforme, ou un réseau social, peuvent précipiter le chaos ou décider d’une élection. Comme le dit Cassius, « César ne serait pas César, si les gens n’étaient pas des moutons ». On se laisse embarquer par la rumeur et le mensonge. Le cynisme politique passe essentiellement par le langage chez Shakespeare.Il analyse les mécanismes qui orchestrent ce glissement qui nous mène de la République à la dictature. De la paix à la guerre. On voit bien d’ailleurs que c’est dans la dimension masculine que ça se joue. Ce qui est effrayant dans la pièce, c’est de voir que Shakespeare, dans un regard sur le passé, formule un avertissement sur le futur. Car on se rend compte qu’on n’a pas bougé aujourd’hui : le retour de Trump témoigne du disque rayé de notre histoire.
Pourquoi transposer la pièce dans les années soixante ?
Je construis toujours mes spectacles dans un contexte : j’ai fait celui-là pour l’American Repertory Theater, financé par Harvard, qui était un des derniers théâtres « non profit », artistique, financé par du mécénat, pour être un théâtre d’art. C’est là qu’avaient commencé les grandes figures du théâtre américain, comme Peter Sellars, David Mamet ou Bob Wilson. Quand j’y étais, c’était Robert Woodruff qui dirigeait le théâtre. Il invitait des metteurs en scène du monde entier, comme Kristian Lupa par exemple. Ce théâtre avait une troupe aussi, était donc un théâtre important dans les années 70, dans une ville, Boston, berceau démocrate et ville de Kennedy. Tout cela me ramenait à ces temps-là, plus qu’à l’actualité américaine immédiate, qui était les années W. Bush. J’ai donc voulu placer la pièce dans un temps d’espoir, d’effervescence artistique et politique. Et puis, on sentait encore la présence du fantôme de Kennedy. D’autant plus qu’au moment où on répétait le spectacle, arrivait sur la scène politique Barack Obama. L’histoire intime du spectacle est d’avoir été créé avec l’avènement d’Obama, et de se poursuivre aujourd’hui avec le retour de Trump. Qu’est-ce qui s’est passé ? La question traverse le spectacle, souterrainement.
Il y a une allusion directe à l’élection de Kennedy, ce sont ces micros suspendus au-dessus de la scène, qui renvoient au débat filmé entre Kennedy et Nixon : on a su après que les gens qui avaient écouté le débat à la radio avaient plutôt voté Nixon, et que ceux qui l’avaient regardé à la télévision, avaient voté Kennedy. On est dans le début de l’ère médiatique, c’est aussi l’époque de l’arrivée des conseillers en communication. La pièce raconte d’ailleurs la fabrication d’un mythe médiatique, celui de Jules César. Comme l’annonce Cassius : « et pendant combien de siècles encore verra-t-on encore représenter ce sublime spectacle dans des nations et des langues encore inconnues ? ». Parle-t-il de l’assassinat de Jules César ou de la pièce de Shakespeare ?
Une scène marque le cœur du spectacle ; l’assassinat de Jules César, et sa fin spectaculaire…Comment l’avez-vous pensé ?
Il est très difficile aujourd’hui de représenter la mort au théâtre, parce que les gens sont habitués au spectaculaire. Mais je me suis dit, s’il a été frappé de 33 coups, il faut faire les 33. L’idée est de donner le temps à la mort : on a ralenti les scènes de mort de chacun, comme pour forcer le spectateur à aller au bout de ce moment-là. Mais pour revenir à la scène de l’assassinat, je voulais trouver un moyen de faire entendre la rage de Jules César, voilà pourquoi son spectre pousse un cri de guerre, qui annonce le déchaînement qui va suivre. Est-ce que c’est la rage de César, ou de Dylan qui joue César ? Il y a une ambiguïté pour moi.
Le personnage le plus fascinant de votre mise en scène, c’est Brutus : est-ce que c’est une poupée entre les mains de Cassius, ou un homme aveuglé par le désir de pouvoir ? Vous ne tranchez pas.
Les trois-quarts des répétitions reposent sur le travail sur le texte, pour l’entendre de manière la plus ouverte possible. J’ai une grande foi dans le performatif, comme dans la pièce, lorsque Marc-Antoine dit « quand César dit quelque chose, alors ça arrive. ». C’est cet endroit-là que je cherche avec les acteurs. Or, le texte de Brutus est très étonnant, car au début, Cassius dit « Brutus est au trois-quarts nôtre ». Ensuite, sa femme, Porcia, dit « qu’elle n’est que sa moitié », et à la fin, Marc-Antoine dit de lui « enfin il est un, il est un homme. ». Comme si toute l’expérience du spectacle permettait à Brutus de devenir qui il est. Il y a donc quelque chose de très flottant chez Brutus. Peut-être qu’au départ il n’est qu’un vase vide, et ce sont les paroles des autres qui vont venir le remplir. Je crois que les Américains ont été très étonnés de cette nature mélancolique de Brutus, car d’habitude on le représente en héros. Pour eux, c’est souvenu vu comme « une pièce de mecs, de buddy, de guerriers ». Alors qu’en fait, tout le dernier acte, ce sont 8 suicides consécutifs ! Il ne faut pas oublier qu’il a fait Hamlet après. D’ailleurs, je me disais, au début d’Hamlet, le père, Claudius, est assassiné par un poison dans l’oreille, comme ce que fait Cassius à Brutus : verser le poison verbal dans l’oreille. Mais il ne faut pas oublier que Jules César a été créé pour l’inauguration du Globe, et ce n’est pas rien de proposer une pièce aussi politique en ouverture : une telle pièce sur la puissance de la parole…
Julius Caesar, de William Shakespeare, mise en scène d’Arthur Nauzyciel, TNP de Villeurbanne, du 23.01 au 01.02, Théâtre des Gémeaux, Sceaux, du 6 mars au 15 mars.