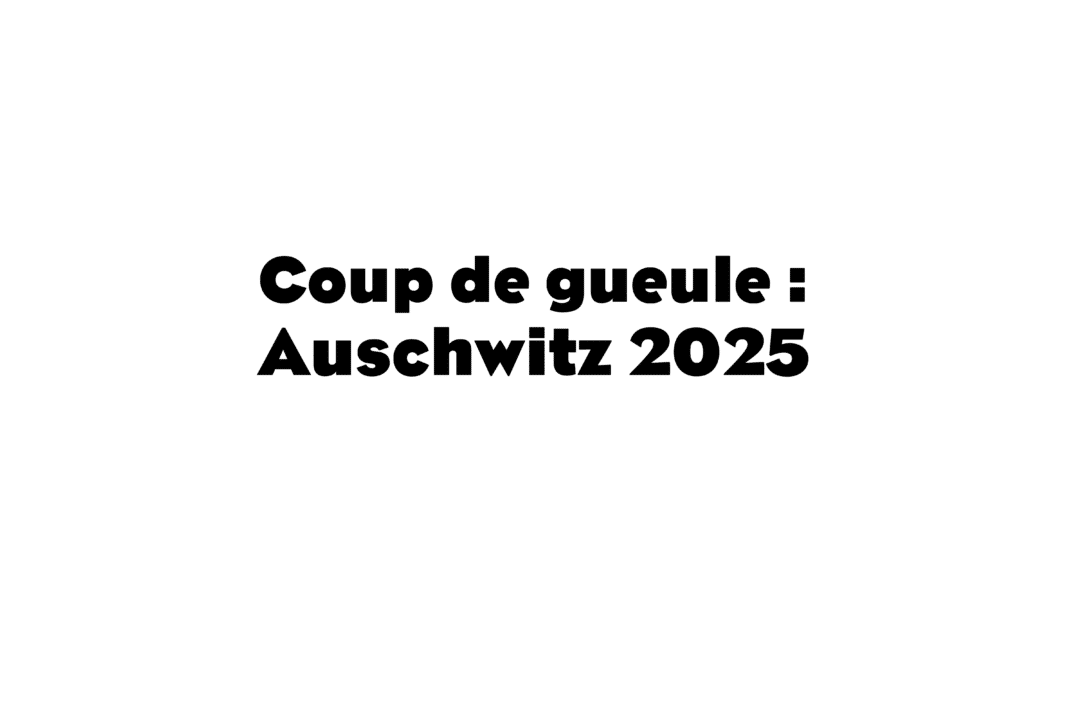Hommage du monde culturel aux 900 000 Juifs morts à Auschwitz, 80 ans après la Shoah. Dans le brouhaha politico-médiatique général, retour sur une expérience réelle.
Dimanche 2 février 2025. Une semaine après les célébrations du 80e anniversaire de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, 2 avions, 7 cars et plus de 300 personnalités du monde culturel ont embarqué pour un voyage aussi nécessaire que singulier. Côte à côte, silencieux et encapuchonnés, directeurs de musées (Versailles, le Louvre Lens, l’Orangerie, le Palais de Tokyo…), galeristes (Emmanuel Perrotin, Marion Papillon, Daniel Templon, Nathalie Obadia…), journalistes, patrons de presse, réalisateurs, metteurs en scène, écrivains, philosophes, comédiens, peintres… Beaucoup faisant ce pèlerinage pour la première fois, attentifs aux paroles des médiateurs du Mémorial de la Shoah venus les accompagner pour leur raconter l’indicible. Dans ce terrifiant camp de la mort, 1,3 million de personnes ont été déportées par le régime nazi entre 1940 et 1945 – parmi lesquelles au moins 900 000 Juifs ont trouvé la mort. C’est en foulant le sol boueux et visqueux de l’immensité de Birkenau, triste plaine évanouie dans la brume glaciale de l’hiver, que l’on tente de ressentir l’inimaginable. Le regard se floute, l’horizon sans fin ressemble aux grandes abstractions maculées de gris et de rouge du peintre allemand Gerhard Richter, sobrement intitulées « Birkenau », grillage de pigments dissimulant quatre photographies prises pendant l’été 1944 dans le camp par des membres du Sonderkommando. Au loin, les miradors solitaires toisent les lignes droites creusées dans le sol qui rappellent la multitude des baraquements autrefois alignés, aujourd’hui presque tous disparus. Les restes des fours crématoires gisent à l’image de grands corps malades dynamités. Nulle trace de canons ou d’obus, nul vestige de conflits. Seuls des briques éparses, des restes de paillasses et les rails funestes qui amenaient ici des convois de toute l’Europe. Mécanique implacable de la Solution Finale. Dans le camp d’Auschwitz, mieux conservé, les blocs encore debout font désormais office de musée. On déambule dans les salles, de rares photographies témoignant de la « sélection » sur le quai de débarquement, entre les âmes autorisées à rester en vie et celles immédiatement envoyées dans les chambres à gaz. A d’autres endroits, des amoncellements de chaussures, de vêtements, de jambes de bois, de cheveux de femmes… Amas informes, noircis par le temps. Ce que les nazis avaient méticuleusement gardé de leurs victimes. On pense alors à l’immense installation que Christian Boltanski avait réalisée sous la verrière du Grand Palais en 2010, montagne de vêtements d’une modestie aussi émouvante que glaçante. Boltanski nous manque aujourd’hui. Qu’aurait-il fait dans le contexte actuel, si singulier ?
Sentiment de dystopie
Car si s’atteler au devoir de mémoire devrait être aussi naturel qu’évident, si se recueillir sur ces traces ineffables devrait relever d’un effroi égal et d’une conviction commune au regard de l’horreur du système génocidaire mis en place dans le cas particulier de la Shoah, cette tragédie est aujourd’hui minimisée au prétexte que d’autres conflits effroyables ont lieu. Par ceux-là mêmes qui nous crient haut et fort qu’il est indécent de faire la hiérarchie des crimes et des morts. Comparer les époques conduit souvent à l’écueil d’un révisionnisme dangereux. Alors laissons les morts de la Shoah (6 millions) reposer en paix, parce que quoiqu’en pensent ceux qui veulent relire l’histoire à l’aune des exactions actuelles, nul autre peuple n’a subi dans sa chair et sa culture une telle éradication, à si grande échelle.
C’est donc après l’émotion, le sentiment de dystopie qui nous étreint. Parce que nous vivons un moment historique loin d’être anodin. Le monde culturel aurait-il failli à son devoir ? Comme l’a énoncé Yonathan Arfi, président du CRIF dans un très beau discours qui a raisonné au-dessus des âmes perdues de Birkenau : « L’art, la culture nous permettent précisément de savoir sans pouvoir voir. Après la libération des camps, la création est devenue un moyen de dire l’indicible, de témoigner de l’horreur vécue.» Or le monde de la culture semble ne plus savoir et ne plus voir. Il s’est fracturé en deux avec une intensité inédite. S’est politisé au point d’organiser des programmes d’exposition nourries de propagande. Tout cela après le 7 octobre 2023.
Dérive du milieu culturel
Souvenons-nous des tracts No Death in Venice – No to the Genocide Pavilion jonchant le sol de la Biennale de Venise au printemps dernier. Dans le même temps, artistes, galeristes et critiques d’art juifs étaient victimes d’un ostracisme soudain et fulgurant. Dérive du milieu culturel ? Simone Veil en 2004, alertait déjà devant le Bundestag : « Quand on banalise le génocide juif par toutes sortes d’amalgames ou qu’on exploite les clichés de la propagande antisémite au service du combat antisioniste, l’Europe a le devoir d’arrêter ces dévoiements, non seulement par respect pour les survivants de communautés décimées il y a soixante ans, mais aussi par souci de sa propre dignité. » Dystopique oui, car est-il normal de devoir encore rappeler cela ? Les organisateurs de ce voyage le soufflent doucement : «Avec tout ce qu’il se passe dans le monde de la culture, nous avons décidé de faire ce voyage… » Dystopique, oui, cette chronique, pour avoir encore à rappeler cela.