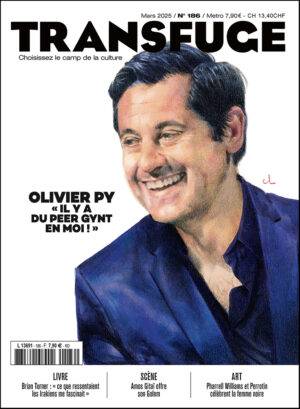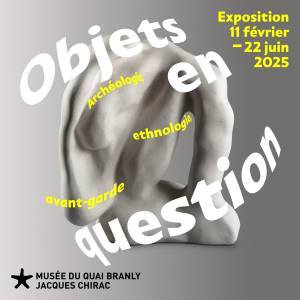Edith Bruck publie Contrechamp, roman poignant de la survie pour une ancienne déportée, à travers le tournage d’un film qui cherche à reconstituer le camp de concentration.
Contrechamp est un roman des zones grises : temporelles, géographiques, psychiques et esthétiques. Nous sommes au lendemain de la guerre, dans un pays européen de l’Est, auprès de Linda, juive hongroise rescapée d’Auschwitz, ( comme Edith) embauchée comme « conseil » sur un tournage de film, sur les camps. Elle ne le cite pas, mais il s’agit du film Kapo de Pontecorvo, sorti en 1960. Fameux film qui avait engendré un débat sur la possibilité de filmer les camps, et plus largement sur l’impossible « spectaculaire » du traitement de la déportation. Jacques Rivette avait fait du « travelling de Kapo » le point de non-retour de la morale en cinéma. Il est passionnant de lire Contrechamp en gardant en tête le débat sur le film, tant les éléments dérangeants sont déjà présents dans le récit d’Edith Bruck ; la nonchalance du cinéaste, l’angoisse de l’actrice principale, les postiches portées par les fausses déportées… Et cette présence lointaine de l’actrice française qui semble si triste que notre narratrice la croit juive, Emmanuelle Riva. En parallèle du tournage, nous découvrons les rues grises de l’Europe centrale des années cinquante, parmi une population traumatisée par la guerre, tenue par la peur des nouveaux maîtres soviétiques, et par un silence difficile à rompre. La scène d’ouverture voit la jeune femme entrer dans un magasin, et se faire tabasser. Pourquoi ? Nulle explication, les évènements arrivent sous la plume de Bruck dans le même enchaînement de logique intérieure d’un roman de Kafka. La jeune femme, bouleversée, cherche à porter plainte, mais dans ce pays étrange, les visages sont fuyants, les paroles troubles. À l’hôtel, sur le tournage, les acteurs, le réalisateur poursuivent leurs activités, niant le bras plâtré de Linda. Monte en elle un sentiment de la violence qu’elle croyait perdu, et qui vient se mêler douloureusement à la reconstitution de la vie concentrationnaire dont elle doit garantir le réalisme. Ainsi l’angoisse s’installe, crescendo : « dans chaque uniforme, dans chaque douanier, dans chaque Monsieur bien habillé, (…) je voyais un ennemi potentiel. » Sur le tournage, parmi les faux déportés, et les faux kapos, elle se sent de plus en plus déplacée : « Je me sentais mal, comme une femme qui braderait, banaliserait, galvauderait sa propre expérience de souffrance. » Au centre du récit, la question posée par le titre, « contrechamps » : quelle perspective trouver pour raconter l’indicible ? Edith Bruck tente de décrire à l’actrice américaine qui tient le rôle central dans le film ce qu’elle a pu ressentir au cours des années passées au camp : « Folie sans perdre la raison, et même plutôt, en raisonnant, en pensant, quand les autres prisonnières dormaient, mouraient, gémissaient ou volaient et se disputaient. » Mais l’actrice lui répond, « Oh shut up ! Je ne veux pas entendre toutes ces choses-là ! ». Dans cette atmosphère rageuse et brumeuse, plusieurs scènes érotiques viennent rétablir une réalité charnelle aux personnages. Et avant toute chose à Edith Bruck, qui réussit là un livre qui vient par sa mélancolie ajouter à son témoignage de rescapée, si justement transmis dans Le pain perdu. Elle témoigne avec force de cette question du « contrechamp », qui n’est autre que le regard que le monde essaie de poser sur Auschwitz depuis aujourd’hui soixante-dix ans.
Contrechamp, Edith Bruck, éditions du Seuil, 140p., 18€