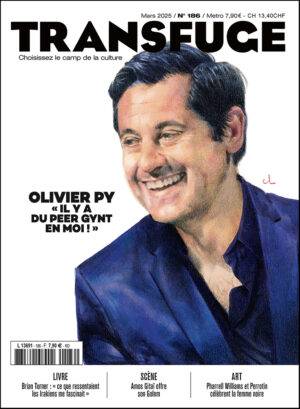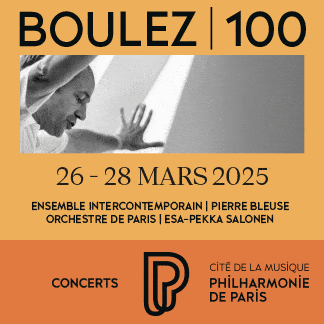Conçue avec un soin admirable, riche de mille aperçus, ponctuée de pièces parfaitement choisies : l’exposition Objets en question du quai Branly est une grande réussite.
D’objets, il va être abondamment question dans les quelques lignes qu’on s’apprête à écrire, mais objets ressortissant à cette catégorie à laquelle on attache l’étiquette « trouvés » – à la condition expresse d’envisager l’épithète dans sa plus grande extension. Statuettes, masques, monnaies, instruments de musique… : autrement dit, essentiellement ce qui fournit sa matière première à l’archéologie, à l’anthropologie, à l’ethnologie. Tout ce qu’on découvre, excave, rapporte.
Quant à moi, pour l’heure, ce que je découvre, excave et rapporte de ma bibliothèque, c’est le Dictionnaire de l’objet surréaliste, qui s’ouvre, comme sous le doigt feuilleteur et souverain du hasard, à la page 46, où me sautent aux yeux ces mots de Gérard Wajcman : « Objet qui fait ouvrir la bouche et les yeux. (…) rien n’interdit (…) de poser que sera déclaré d’art tout objet qui renfermerait une telle puissance de réveil. » Vous vous endormiez, bercé par le ronron de mon premier paragraphe ? Eh bien, cette locution, « puissance de réveil », doit être assez forte pour vous tirer de votre somnolence. Elle désigne en tout cas très exactement, avec cette justesse qu’ont seuls les accidents que sont les trouvailles fortuites, la pulsation vitale de l’exposition. Car, s’interrogeant sur les rapports (contiguïté, assimilation, recouvrement) entre le domaine scientifique et le domaine artistique, et postulant que les objets susdits sont à l’intersection des deux, elle donne à ces derniers toute latitude d’exprimer leur vertu excitatrice. De réveiller la pensée et le regard.
Comme ils l’ont fait dans l’entre-deux-guerres. Car ce n’est pas pour la commodité de la restriction de champ que l’exposition s’est fixée sur cette période. Une de ces conjonctions, qui se traduit ordinairement par une singulière effervescence des idées et des œuvres, se produisait alors : les gens en « -ogues » (archéologues, etc.) étaient au diapason des avant-gardes, en particulier des surréalistes. « Les milieux, explique un des quatre commissaires, Philippe Peltier, devant cet objet fort peu magique, mais bien utile, qu’est mon petit enregistreur de poche, sont très poreux. Et il y a aussi l’idée que l’art contemporain travaille dans le même esprit que la préhistoire et les sociétés exotiques. » Période d’éveil, sans doute, qui nécessite naturellement des éveilleurs. C’est le milieu nourricier, tout saturé d’électricité intellectuelle, des revues : Georges Bataille et Documents, Minotaure dans la grande ombre de Breton, ou encore les Cahiers d’art de Christian Zervos. Sans oublier les musées : Trocadéro, Louvre ou Antiquités nationales.

Aurores et révolte
On dirait qu’une aurore matinale est partout épandue. Tout paraît s’animer. Ces « objets » particuliers que sont les signes regorgent de sens comme le dormeur d’énergie recouvrée au terme de sa nuit : graffitis de Brassaï, manuscrit pictographique rapporté par Alfred Métraux de Colombie, et surtout ces extraordinaires peintures du Songo, publiées par Michel Leiris dans un numéro de Minotaure consacré à la mission Dakar-Djibouti, et qui, tels des papiers découpés, semblent les lettres d’un alphabet graphique. Très belle idée aussi que d’avoir rapproché, en une suggestive triade, une statuette cycladique, devant laquelle on reste longtemps à rêver, un dessin de Giacometti où figure, tel un relevé de fouilles, une « idole cycladique » et une superbe Composition bleue de Miró : comme si la première, passée par l’étape intermédiaire du deuxième, prenait vie chez le troisième, sortant de son sommeil de marbre.
Plus loin, on se prend à murmurer du Nerval : « Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours ! » Tant l’archéologie exerce son empire sur les esprits : ainsi Cnossos, et la fortune, qu’on sait, du Minotaure, chez les surréalistes (avec un prodigieux Masson, ici, en guise d’illustration). Réveil des mythes ? Peut-être – en tout cas, éveil de nouvelles notions, de nouveaux concepts, au contact, par exemple, des masques africains. Ailleurs, des harpes africaines jouent moins d’harmonieuses mélodies qu’elles n’introduisent une vivifiante dissonance dans la pensée, lui interdisant ainsi la paresse : instruments de musique ou œuvres d’art, comment trancher ? L’une des figures reines de la pensée scientifique est alors la comparaison (cette grande éveilleuse d’autres significations) que l’exposition rapproche éloquemment du cadavre exquis. Dont un très bel exemple, dû à Breton, Marguerite « Ghita » Luchaire et Pierre Unik, avec femme allongée et fond noir, pourrait bien être une incursion plastique dans le monde du sommeil.
Mais on n’est pas là pour dormir, et voici que se dresse une inoubliable et longiligne statuette (Latium ou Etrurie), comme pour nous inciter à ne pas nous laisser aller au doux assoupissement de la rêverie de l’interprétation. Et voici le fameux Objet désagréable de Giacometti, et le non moins fameux cliché de Man Ray, et tout ce que ce bec-verge recèle d’agressivité. De puissance de révolte. Aussi bien, me dis-je (mais peut-être est-ce une hypothèse à dormir debout ?), les forces d’éveil libérées par tous ces objets ont-elles peut-être contribué à allumer la flamme de la rébellion surréaliste…

Objets en question, musée du quai Branly-Jacques Chirac, jusqu’au 22 juin
Visuel : Masque d’épaule. Bois avec costume en fibres (manquant).Entre 1850 et 1902. Bois (Afzelia africanas). Afrique, Guinée, population Baga.© musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Claude Germain.