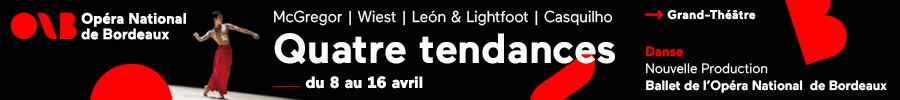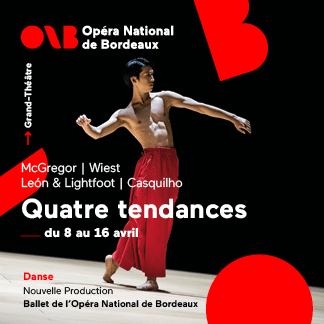Le Théâtre de la Ville avait réuni plus de dix artistes venus d’Iran, d’Ouzbékistan, du Kirghizstan et du Kazakhstan, dimanche 23 mars, place du Châtelet à Paris, pour célébrer Norouz dans la joie des musiques et des chants, qui vient rappeler les liens profonds de l’Homme avec la Nature.
Norouz fête le retour du printemps avec joie et exubérance en Iran et dans tous les pays de l’ancien Empire Perse, au Moyen-Orient, au Kurdistan, en Afghanistan… Pavoisé de jacinthes blanches, le Théâtre de la Ville accueillait pendant toute la journée de ce dimanche des musiciens et des chanteurs, vêtus des tenues traditionnelles de leurs pays respectifs. Le grand hall du Théâtre était parfumé des gastronomies persanes à l’heure du déjeuner – riz safrané, dattes, baklava… – après un premier concert à 11 heures réunissant trois jeunes artistes nées en Iran. La chanteuse kurde Sara Eghlimi accompagnait la compositrice Farnaz Modarresifar et ses délicates improvisations au santour, cithare sur table dont les cordes sont frappées avec deux petits marteaux recourbés, les mezrabs. Niloufar Mohseni complétait joliment le trio au tombak, tambour traditionnel iranien, dont la percussion des doigts fait un peu penser aux sonorités rebondissantes de la tabla indienne.
En milieu d’après-midi, le souffle rauque des steppes kazakhes vint saisir la grande salle, emportée par les mélopées gutturales de Uljan Baybusynova. Etonnante chanteuse zhyrau, elle jouait de sa dombra, luth à deux cordes en mûrier, quand le kobyz d’Aigerim Shuster, vièle sacrée aux déchirants accents élégiaques, auraient ému un coeur de pierre. Le zhyrau mêle dans son chant épique des récits hypnotiques de chevauchées nomades, des réflexions philosophiques, intercédant auprès des ancêtres.
Plus tard, le duo des frères Kanybekov, « acrobates » du komuz, luth à trois cordes kirghize, faisait galoper leurs mélodies instrumentales avec une virtuosité époustouflante. Avant de laisser la place à un trio de chanteurs ouzbèkes, inspirés par les fêtes de Boukhara, haut lieu du soufisme depuis le XVIIe siècle, où s’entremêlaient les cultures tadjikes, ouzbèke et juive. Tambours et luths rythmaient le jeu subtil des mains de la danseuse Zamira Aminovar, flammes gracieuses « d’un feu incandescent ».
La qualité des artistes présentés tout au long de la journée a conquis un public très nombreux, envouté par ces univers musicaux trop rares dans nos grandes salles culturelles.
Visuel : S. Eghlimi, F. Modarresifar, N. Mohseni Nadège Le Lezec