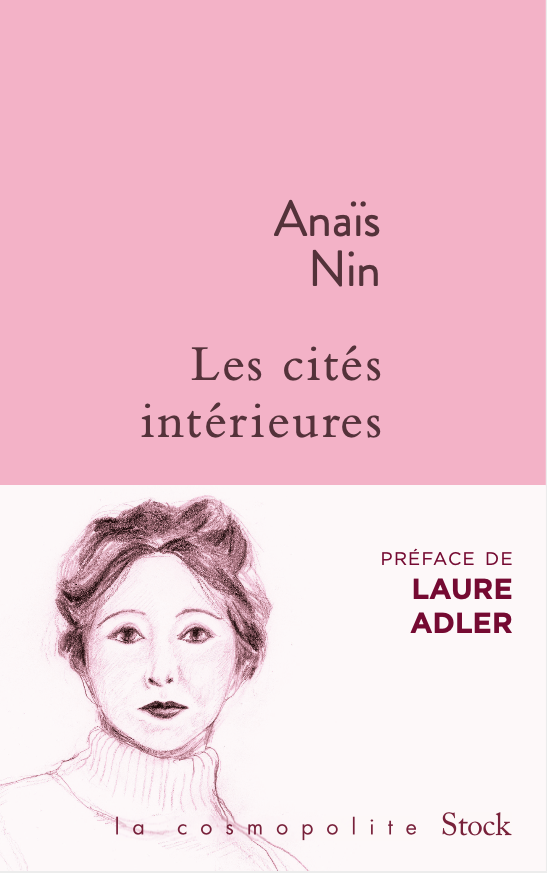À l’occasion de la réédition des Cités intérieures aux éditions Stock, Transfuge a choisi de mettre à l’honneur Anaïs Nin en UNE de son numéro de février . Tout au long de son Journal, l’écrivaine n’a eu de cesse de rapporter sa vie sexuelle. Ce qui ne pouvait que susciter l’intérêt de Catherine Millet, l’auteure, justement, de La Vie sexuelle de Catherine M…
Si les anges n’ont, dit-on, pas de sexe, les écrivains en ont un. Qui sous-tend leur écriture, tend leurs phrases et font de leurs livres, de l’Arétin à Garth Greenwell, autant d’aventures de la sexualité, trépidantes ou patiemment exhaustives. Anaïs Nin fut l’une des grandes exploratrices de ce continent pulsionnel, tout comme Catherine Millet qui, dans La Vie sexuelle de Catherine M., s’était aventurée, avec l’audace et la précision d’une franchise qui n’a pas froid aux yeux, sur ces terres. Que pense-t-elle de sa devancière, elle qui a aussi mis à nu les replis les plus intimes de sa vie ?
Comment Anaïs Nin est-elle entrée dans votre vie de lectrice et d’écrivain ?
J’avais d’abord été une lectrice du Journal dans sa première édition, expurgée. C’était une figure importante, une sorte de mythe mais, littérairement, je n’avais pas tellement « accroché ». Mon intérêt s’est vraiment éveillé plus tard, avec son livre sur D.H. Lawrence, qui m’a poussée à lire beaucoup plus Lawrence mais aussi, dans la foulée, les petits romans d’Anaïs Nin et surtout son Journal dans l’édition non expurgée. J’ai découvert alors qu’il s’agissait d’un écrivain important.
Un écrivain important, pourquoi ?
À cause de l’effet de vérité. Ce qu’on lit dans le Journal a certes été forcément retravaillé, en particulier pour les journaux de jeunesse, où on se dit que l’écrivain adulte a dû repasser sur ce qu’elle avait écrit à douze ou treize ans. Pourtant, malgré ce travail de réécriture, elle est au plus près du réel et avec un grand sens du concret. Souvent, quand on me demande ce qui différencie les écritures masculine et féminine, je réponds qu’il y a chez les femmes un sens du concret, du prosaïque, qui est fréquemment absent chez les hommes.
Vous êtes nourrie de la grande tradition de la littérature libertine, les Sade, les Casanova… Peut-on rapprocher Anaïs Nin et l’entreprise qu’est son Journal de cette lignée ?
Je dirais oui, au moins pour une raison, qui est le systématisme. Ce systématisme qui caractérise le meilleur des auteurs libertins, puisqu’ils racontent tout. Ce qui donne des écrits fleuves – avant Anaïs Nin, il y a eu Casanova… Il y a cette volonté de tout dire qui vous met dans la nécessité de tout raconter au fur et à mesure et le Journal est assez exceptionnel de ce point de vue. Il y a aussi cet autre trait des libertins : ils sont toujours dans la course à l’expérience nouvelle, ce qui donne d’ailleurs le caractère très répétitif qu’on reproche souvent à ces écrivains. Mais c’est dans la répétition du même qu’ils cherchent la différence, la petite chose en plus qui va satisfaire leur désir. C’est la nature du libertin : être très systématique pour trouver quelque chose qui les mène plus loin dans le plaisir et peut-être dans la restitution de ce plaisir à travers l’écriture.
Une libertine, donc, sans aucun doute, mais une féministe, c’est moins sûr semble-t-il. On a souvent fait grief à Anaïs Nin de son absence d’engagement politique à cet égard…
Il faut d’abord dire que, au début en tout cas, sa situation objective était extrêmement conformiste, c’était une bourgeoise : elle était entretenue par un mari qui non seulement gagnait bien sa vie mais était libéral et la laissait vivre. Elle n’était donc pas dans une situation de revendication sociale. Restait la liberté sexuelle, et là elle ne rencontrait pas d’entrave. Il n’y avait pas de raison pour qu’elle adhère à un quelconque mouvement féministe. Par ailleurs elle ne pouvait pas se reconnaître dans une action féministe en lutte, sinon en guerre, avec les hommes. Elle aimait trop les hommes pour ça et elle les aimait dans tous les sens du mot. Une chose qui m’a toujours frappée dans son Journal, c’est à quel point elle était empêtrée dans les histoires sentimentales. Il y avait la sexualité, mais aussi l’attachement aux uns et aux autres, tous les nœuds subjectifs que cela pouvait créer, et dont elle tentait de se dépêtrer.
Anaïs Nin, Les Cités intérieures, éditions Stock, préface de Laure Adler, 620p., 26 euros