Dans un thriller en trompe-l’œil, Mikhaïl Chevelev analyse avec lucidité la déliquescence économique russe après la perestroïka.
Journaliste dissident, Mikhaïl Chevelev a publié en 2021 un roman où il mettait en scène un personnage à son image : Une Suite d’événements, titre euphémistique, tirait profit d’une enquête pour décrire les enjeux sous-jacents du régime russe contemporain. Sous des dehors de thriller parodique et de drame psychologique, Le Numéro Un, son second roman, tient aussi du reportage ; l’intrigue se déploie sur un arc de temps qui va de la fin de l’Union soviétique à l’expansion de la fédération de Russie, de 1984 à 2018. À la suite d’une affaire de marché noir, Vladimir (Volodia)Lvovitch est victime d’un maître-chanteur du KGB qui mise sur sa peur pour le neutraliser — « une vraie peur, gluante, paranoïde », synonyme de goulag. Cet incident aura des répercussions lorsque, après la perestroïka, il émigrera à New York avec sa femme et leur fils de deux ans. De retour à Moscou, on lui confisque son passeport et l’oblige à divorcer. Vingt ans plus tard, un concours de circonstances convainc David Kapovitch (le fils, qui porte le nom de sa mère), de retrouver la trace de son père. Le voici embarqué dans une aventure rocambolesque, en quête du « numéro un » (pervoe litso, en russe : le « premier visage ») du réseau qui a piégé Volodia.
La veine satirique de Chevelev s’inscrit dans la lignée d’un grand prédécesseur, autre Mikhaïl, victime de la censure soviétique : Boulgakov. Le Numéro Un est jalonné de stéréotypes, mais comme ils figurent dans les dialogues, on devine que l’écrivain caricature les tough guys de la mafia (mercenaires plutôt qu’assassins) et que Christine Zeytounian-Beloüs, la traductrice, au demeurant brillante, a renoncé à leur attribuer un argot, à tort peut-être, car les métaphores de la pègre ne sont pas moins savoureuses en français. Si scabreuses soient-elles, les expressions paraissent d’autant plus fraîches qu’elles sont traduites à la lettre : « Je suis calme comme une vache qu’on vient de traire », note David (le fils).
Le roman sert de prétexte à la fine analyse économique d’un pays livré en pâture aux bandits et aux aventuriers cyniques dans le genre d’Édouard Limonov : « C’est un gâteau commun que mangent les retraités aussi bien que les oligarques. Et si quelqu’un rafle une trop grosse part, c’est que quelqu’un d’autre est condamné à se serrer la ceinture. » La débâcle consécutive à la glasnost a favorisé les détournements de fonds, les dessous-de-table et les réseaux capillaires de blanchiment : « Nous faisions sortir l’argent de Russie pour l’envoyer vers les États-Unis en passant par une longue chaîne d’offshores et de blind trusts et il se transformait en propriété immobilière légalement acquise et en divers autres biens. » Six milliards de dollars sont ainsi légalisés par une entreprise tentaculaire dont une succursale a pour siège social la synagogue de Brooklyn.
Les Russes n’ont pas fini de régler leurs comptes avec eux-mêmes, suggère Chevelev tout au long de cette « liquidation » jubilatoire où l’on entend, à chaque page, se casser les cordes des balalaïkas.
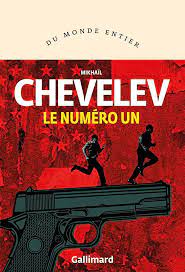
Le Numéro Un, Mikhaïl Chevelev. Traduit du russe par Christine Zeytounian-Beloüs. Gallimard. 176 p., 18 €










