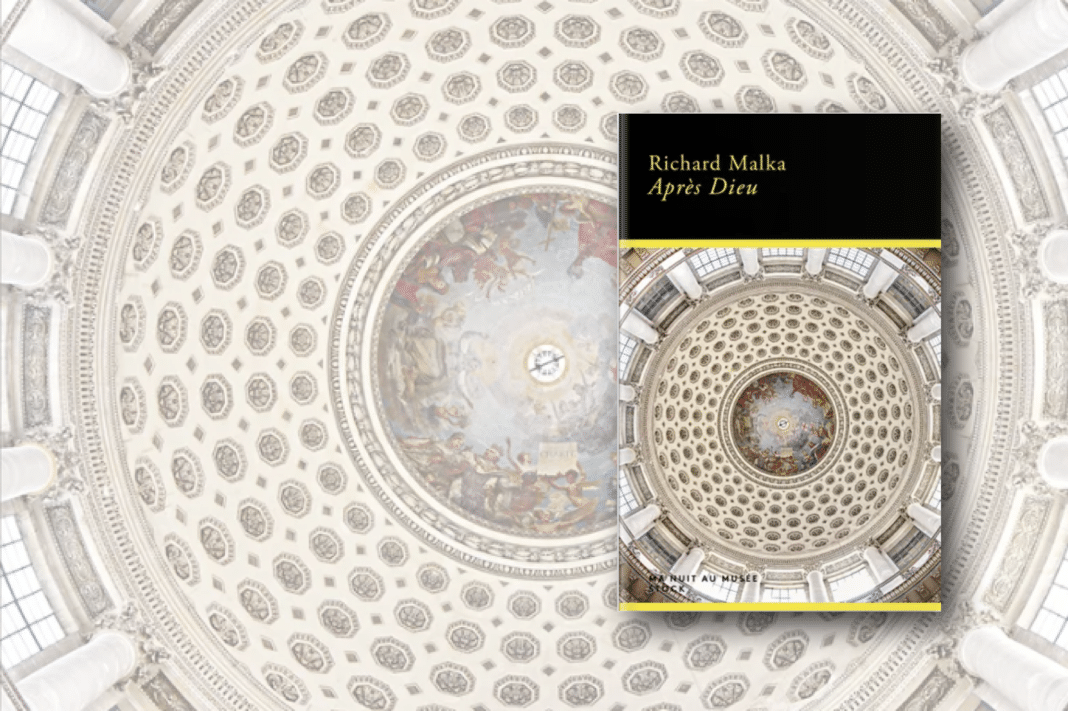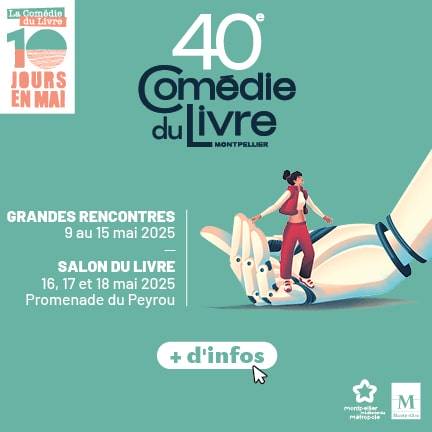Passer la nuit dans un cimetière pour chercher l’inspiration de l’écriture n’est pas une simple aventure spirituelle, mais aussi une aventure philosophique, historique et sentimentale. C’est ainsi que Richard Malka a choisi d’écrire son nouveau livre Après Dieu. Au Panthéon, il entreprend un voyage à travers l’histoire de la République et les questions les plus délicates d’aujourd’hui, dans un échange passionnant avec François-Marie Arouet, dit Voltaire.
Dans ce voyage, on est accompagné par les voisins du philosophe des lumières, ceux qui sont « morts pour cause de fanatisme. Ce même fanatisme religieux que nombre d’occupants des lieux ont combattu mais aucun autant que toi. Jean Jaurès, Jean Moulin, Missak Manouchian… » Ils sont tous dans ce bâtiment splendide où Richard aborde son origine unique, quand Louis XV tombe malade à 34 ans : « Le ciel du roi très chrétien l’entendra en lui envoyant un médecin juif. » Il réussit à le soigner. Mais « comme il est inimaginable d’attribuer à un Juif la résurrection du roi de France, on va chercher un vieux médecin de garnison, Alexandre de Montcharvaux, qui est honoré et élevé au rang de héros. C’est ainsi que notre Panthéon fut érigé. » L’église fut donc construite grâce à un Juif, et finit temple républicain ! La première église de ce nouveau monde débarrassé de la tyrannie des prêtres.
L’auteur de Le droit d’emmerder Dieu interroge Voltaire sur plusieurs aspects. Mais la religion reste le sujet principal, car si François-Marie a inspiré les fondateurs de la Révolution française, il a aussi « inspiré aux révolutionnaires la religion de l’humanité ». Ce dernier n’a rien à voir avec la religion, « le pire des tyrans » selon Malka. Voilà pourquoi il propose d’ajouter le mot « athée » au premier article de la Constitution : « ça donnerait : La France est une République indivisible, laïque, athée et sociale. » Parce que Voltaire s’est trompé en pensant que le fanatisme vivait ses dernières heures. « De mon temps, on décapite des enseignants », souligne Malka.
Mais que faire ? demande-t-il à Voltaire. « Il est simplement réclamé aux croyants de tous les cultes de ne pas interférer avec les lois des hommes, celles de la République. » Pour appliquer cela, la lutte pour la laïcité ne doit pas faiblir. Il faut être strict vis-à-vis de l’islam, comme on l’a été avec le christianisme, afin de protéger également les Musulmans en tant qu’individus et de garantir leur liberté. » Cela semble nécessaire dans le monde d’aujourd’hui où « les lynchages se déroulent sur les réseaux sociaux », où « on se joint à la vague de menaces de mort ou d’insultes sans même savoir ce qui la motive ».
La question de la religion est aussi abordée à travers l’enfance de l’auteur, dans un milieu juif, mais peu pratiquant. Il décrit les tenues, le voile imposé, les hommes en redingote et gilet noir, chapeau sur la tête, dans les rues d’Israël. Mais « au fond, peu importent les vêtements, seul compte le message. »
Dans ce texte fluide, éblouissant et d’une finesse rare, offert à « tous ceux qui ont été tués au nom de Dieu », le pilier de la création, comme celui de la vie de Richard Malka, est la liberté : « Vivre librement ou mourir. » C’est la raison pour laquelle l’avocat de Charlie Hebdo propose à Voltaire, qui n’avait pas d’enfants : « j’ai toujours considéré les gens de Charlie comme tes arrière‑arrière‑petits‑enfants. Je suis persuadé que tu les adopterais. »
Ainsi, Voltaire doit être le nouveau Marianne de la France. Malgré les critiques sur sa vie personnelle, sa relation ambiguë avec Émilie du Châtelet, son implication dans le commerce avec des négriers et la légende de sa richesse, Malka affirme que ces accusations reposent souvent sur de faux documents. Ce qui est essentiel selon Malka ? Voltaire s’est opposé au déterminisme : « Il pensait que l’on devait s’inventer, se créer soi-même, et être sa propre origine. » Il a tellement raison, alors même que la liberté d’expression, l’universalisme et l’individualisme sont si menacés.
Après Dieu, Richard Malka, Stock (Ma nuit au musée), 208p., 19,50€