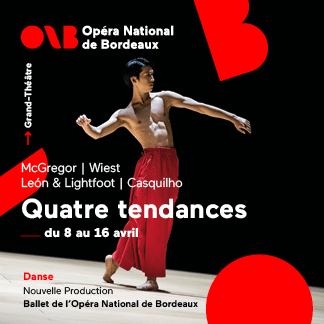Après la mort lente du Roi-Soleil, puis l’étrange errance d’un fonctionnaire, roi de rien, à Tahiti, Albert Serra poursuit son œuvre envoûtante, au bord de l’abîme humain, en investissant les arènes et le terrain miné de la corrida. « Une de mes obsessions, dit-il, a toujours été de créer des images et des situations inédites dans le cinéma ». Avec Tardes de Soledad, Serra touche au but. S’il s’agit bien, ici, d’un documentaire, le réalisateur n’en contribue pas moins à l’art cinématographique en démontrant un réalisme novateur, époustouflant, dont le public ne cessera jamais, probablement, de discuter les intentions. D’une durée de 2h05, le film suit un torero (Andrés Roca Rey) d’une arène l’autre, d’une après-midi l’autre, alternant les séquences presque immobiles – hors le déroulement de la corrida – avec les scènes tauromachiques. Ces variations d’intensité, la force organique de certaines images, l’insistance et la répétition voulues par le réalisateur, finissent par nous déplacer dans un monde complètement ambiguë et terriblement cinématographique. Où l’on découvre qu’il y a quantité de douleur et de grandeur dans un peu de vérité. Et si le documentaire faisait là sa révolution ?
Tardes de soledad va à l’essentiel : à l’affrontement entre deux forces et deux volontés. Cette image resserrée, inouïe, de la confrontation entre l’homme et l’animal donne un résultat visuellement exceptionnel. Cependant vous faites le choix d’exclure un troisième acteur : le public. Or le public des arènes tient un rôle particulièrement influent si on le compare à celui des autres spectacles vivants. Pourquoi ce choix ?
Pour plusieurs raisons. La première est purement esthétique. Il aurait été vraiment dommage de gâcher le dispositif technique que nous avons mis en place dans les arènes, exceptionnel par son ampleur, pour, finalement, voir apparaître sur l’écran la banalité humaine d’un « public ». La deuxième raison est conceptuelle : nous voulions faire un film pour le cinéma. En clair, le public du cinéma devait être le seul public de la corrida (du moins se ressentir comme tel). Nous voulions lui faire expérimenter des sensations loin de la platitude habituelle des captations tauromachiques. Personne n’avait pensé à ça, ni à utiliser les moyens modernes (par exemple les microphones sans fil, cousus sur les habits de lumière) pour transporter de la façon la plus efficace possible una tarde de toros dans une salle de cinéma. Une fois débarrassées du public effervescent et instable des arènes [celles de Madrid, par exemple, se remplissent de plus de 20 000 personnes], les images sont plus fortes, plus ambiguës, on plonge au cœur du drame ; le côté atavique de la corrida ressort spectaculairement.
Le désordre, le tumulte, la violence, la toute-présence de la mort, l’animalisation de l’homme, le déroulement cyclique : comment ne pas penser à Werner Herzog en regardant votre film. Cette comparaison, vous la comprenez ?
Oui, bien sûr. L’audace, l’immersion dans la nature, les éléments sauvages autour de l’homme, les tensions qui en résultent : il y a naturellement des points communs entre mon film et certaines œuvres de Werner Herzog.
La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge
TARDES DE SOLEDAD d’ALBERT SERRA – Sortie le 26 mars.