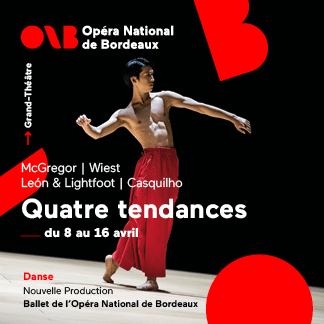Oeuvre testamentaire du compositeur russe, la Khovantchina est un opéra fleuve plein de bruit et de fureur, mis en scène avec brio par Calixto Bieito et servi par une distribution éblouissante.
Il est des opéras de fin du monde. Des opéras qui sentent l’apocalypse, le carnage, le bruit, la fureur. Des opéras dont on se dit que l’auteur lui-même a dû sentir planer l’ombre de la folie (ou du cataclysme) tandis qu’il se battait en duel avec son inspiration. La Khovantchina est de cette famille.
Œuvre testamentaire de Modeste Moussorgski, elle fut créée à Saint-Pétersbourg en 1886, cinq ans après la disparition du compositeur. Rongé par l’alcool et l’épilepsie, le musicien est mort à quarante-deux ans, sans avoir orchestré l’œuvre ni même établi avec précision son dernier acte. Un chantier en friche, auquel Rimski-Korsakov (plus vaillant et sain nécrophage de la musique russe) s’attèle avec courage. A la création, on découvre une œuvre encore plus ambitieuse, encore plus titanesque que Boris Godounov. L’opéra plonge à nouveau dans l’histoire russe sans toutefois se concentrer sur une figure unique. La Khovantchina est une œuvre chorale, qui dépeint les crises politiques et religieuses ayant ensanglanté la Russie des Tsars au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle. Conspirations, trahisons, vengeance, tout passe dans cet opéra fleuve dont la tension ne retombe jamais. Mais une pièce de cette envergure demande une production à sa mesure -copieuse, ambitieuse, donc couteuse- si bien qu’elle est beaucoup moins montée que Boris, et c’est dommage !
Saluons donc l’initiative du Grand Théâtre de Genève, qui se donne les moyens de ses ambitions et nous offre une superbe soirée. Superbe par la version choisie : ce n’est pas l’orchestration de Rimski mais celle de Dmitri Chostakovitch. En 1958, en plein URSS, le compositeur de Lady Macbeth de Mzensk s’est en effet vu confier la tâche de compléter le rébus, qui sera créé au Kirov en novembre 1960. Son travail est sans doute le plus proche du « son » moussorgskien. Le final choisi à Genève est toutefois celui orchestré par Stravinsky en 1913, ce qui nous donne une forme de synthèse du génie musical russe.
Si l’on a pu être exaspéré par le récent Or du Rhin de Calixto Bieito à Paris, on doit rendre les armes devant sa version de la Khovantchina. Le metteur en scène catalan prend l’œuvre comme une fable sur tous les pouvoirs et livre une sorte de cauchemar orwellien, sans chercher à enfoncer les portes ouvertes de la Russie poutinienne. Sa production est tendue, mouvante, inventive, toujours prompte à la laideur (on ne se refait pas…), mais une laideur qui est ici cohérente et justifiée : nous sommes dans une manière de no man’s land postsoviétique où les personnages sont à nus, livrés à leurs pulsions et leur bassesse.
Une Khovantchina digne de ce nom ne saurait aller sans un plateau slave et Genève nous offre une distribution vraiment idiomatique. Figure centrale, le prince Khavanski de la basse russe Dmitry Ulyanov est tout simplement terrifiant ! C’est un ogre vengeur, qui rugit son rôle sans jamais abdiquer sa musicalité. Mais on voudrait tous les citer, car chacun semble profondément habité par son personnage : le prince Andrei Khovanski du ténor Arnold Rutkowski, le Dossifeï de la basse Taras Shtonda, la Emma de la soprano Ekaterina Bakanova… Ce n’est cependant pas une artiste russe qui domine la distribution, mais une Afro-Américaine. Dans le rôle écrasant de Marfa, la mezzo-soprano Raehann Bryce-Davis est hypnotique. Sa présence électrique se double d’un timbre abyssal, aux nuances étonnantes. Elle semble hantée par son rôle et Bieito a su fort intelligemment jouer de son ample physionomie.
Enfin, dans la fosse, la baguette brûlante du chef argentin Alejo Perez enflamme cette partition éruptive et la porte à un vrai point d’incandescence ; une telle musique doit être fouettée au sang.
La Khovantchina, de Modeste Moussorgski, direction musicale Alejo Perez, mise en scène Calixto Bieito, Grand Théâtre de Genève, jusq’au 3 avril. Plus d’infos sur www.gtg.ch