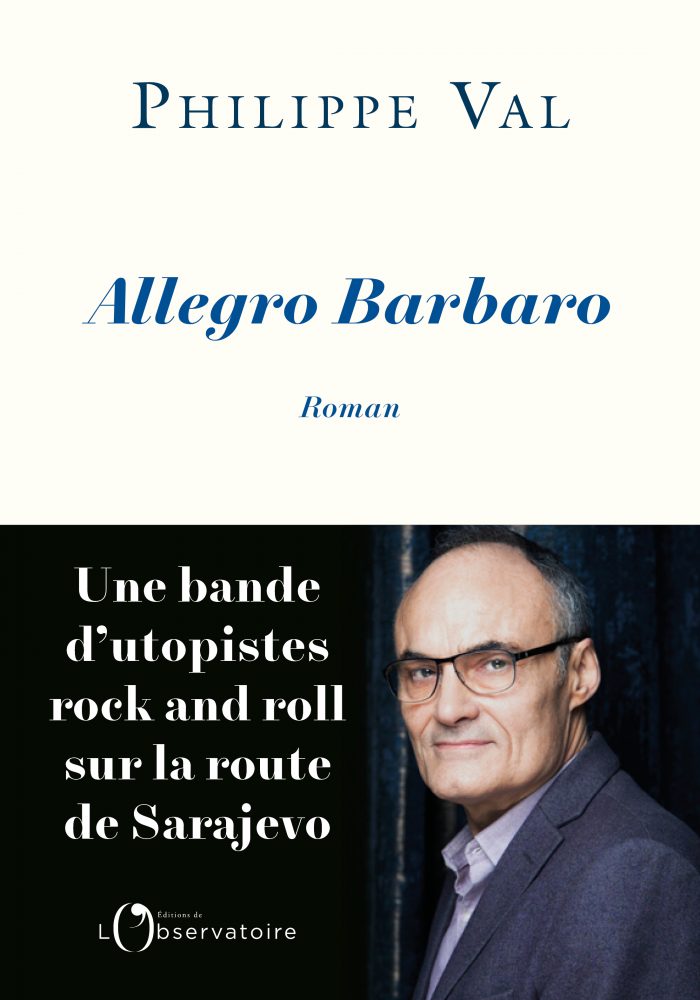Dans Allegro Barbaro (éditions de l’Observatoire), son premier roman, Philippe Val fictionne ses pérégrinations en Bosnie durant la guerre en ex-Yougoslavie qui fut, selon lui, le creuset des fractures au sein de la gauche européenne. À travers le prisme du dissensus entre souverainistes et universalistes, il commente aussi l’actualité récente.
Allegro Barbaro est votre premier roman. Pourquoi avoir choisi de le situer dans le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie ?
Philippe Val – Je pense que cette guerre a été un tournant, notamment dans le monde intellectuel et médiatique français. Dans ce milieu, les gens avaient de multiples désaccords mais se parlaient quand même parce qu’ils avaient des causes communes. Or, à partir de cette guerre, j’ai vu les gens se radicaliser et, pour schématiser, se séparer entre souverainistes et universalistes. Avant, la pensée souverainiste était éparpillée entre la droite et la gauche : là, elle commençait à tisser des liens et à se regrouper, tout en excommuniant ceux qui n’étaient pas d’accord. À l’époque, mon carnet d’adresses en a pris un coup. C’était la première fois de ma vie que je me fâchais sérieusement avec des amis avec lesquels j’avais des désaccords politiques mais qui restaient avant tout des amis. Or, ils devenaient agressifs, écrivaient des choses dégueulasses au nom de la bonne cause serbe. Ces premières fractures annonçaient ce qui allait profondément diviser la gauche entre, pour aller vite, la galaxie sartrienno-bourdieusienne et les autres, plutôt camusiens, les universalistes. Il en a résulté une chaîne de conflits de plus en plus virulents sur la question Israël-Palestine, sur l’antiracisme, etc.
Tout ce qui a trait à la métaphysique de l’origine est désormais un succès. On voit aujourd’hui un culte quasi-animiste de la nature qui va nous coûter très cher à mon sens.
Est-ce que ce dissensus interne à la gauche n’a pas toujours existé : Jacobins contre Girondins, marxistes purs et durs contre sociaux-démocrates, etc. ?
Oui, sauf que la social-démocratie rocardienne a disparu, hélas, laissant sur le carreau des gens comme moi qui se font traiter de néo-cons parce qu’on est contre la destruction de l’État d’Israël. Ces souverainistes ré-idéologisés par le conflit yougoslave ont ensuite combattu le traité de Maastricht, le référendum constitutionnel européen… Voilà pourquoi je voulais écrire un roman situé dans ce bourbier yougoslave, creuset originel d’un virus souverainiste qui a frappé une partie de l’intelligentsia européenne. Et maintenant, une partie de la mouvance écologiste s’y est adjointe. Tout ce conglomérat vit sur une métaphysique de l’appartenance, que celle-ci soit religieuse, territoriale, ethnique… Tout ce qui a trait à la métaphysique de l’origine est désormais un succès. On voit aujourd’hui un culte quasi-animiste de la nature qui va nous coûter très cher à mon sens.
Tout ce que vous décrivez de la situation yougoslave dans votre roman semble très précis dans les moindres détails, qu’il s’agisse des lieux, des personnages rencontrés, des situations, de la météo… Comme si c’était du vécu. Vous avez été en reportage là-bas, à l’époque, ou en tournée en tant que musicien ?
Les deux ! J’avais trente ou quarante pages de notes sur cette expérience, que j’avais gardées en vue d’un roman. Tous les lieux sont réels, et je suis parti de personnages réels que j’ai fictionnés un peu. Marlaud le narrateur et personnage principal, c’est un peu moi : le nom vient de Conrad bien sûr, mais évoque aussi Chandler. C’est un voyage vers le cœur des ténèbres. J’étais mort de trouille durant tout ce reportage-tournée, on a failli crever plusieurs fois. J’y étais allé comme journaliste, la tournée de musicien étant une couverture. L’ONG qui organise la tournée dans le roman existait aussi, de même que son représentant, cette espèce de gourou farfelu.
Je souris de l’absurdité tragique du réel, sans la moindre croyance : dieu n’a rien à nous dire, et la nature non plus.
Le personnage du chanteur, Bob Volta, semble inspiré de Renaud.
Renaud était avec nous dans cette tournée. Mais Bob Volta n’est pas Renaud, plutôt un mix d’artistes de cette époque (Renaud, Léo Ferré, Thierry Le Luron, Coluche…) : une star qui ne va pas très bien, ou qui ne peut aller bien qu’en allant mal. À travers lui, je voulais montrer ce qu’était la bonne volonté militante et sa dangerosité liée à une certaine inconscience.
L’inconscience est une question qu’on se pose pendant tout le livre : qu’est-ce que cette bande de musiciens français est allée faire dans cette galère de la guerre yougoslave, surtout en répondant à la demande d’un gourou très louche ?
Dans les romans policiers français, on sait toujours pourquoi le détective va au bout. Tandis que chez les Américains, des personnages comme Marlaud (ou Marlowe) ne savent pas toujours pourquoi ils y vont. C’est plutôt une curiosité qu’une morale qui les fait avancer avec une éthique de la réalité instantanée. Mon Marlaud est comme ça, il y va et il continue parce qu’il veut savoir, comprendre. Rien ne peut étancher sa curiosité intellectuelle, journalistique, sinon continuer jusqu’au bout. Moi-même, avant mon reportage, le général Morillon m’avait déconseillé d’y aller parce que c’était trop dangereux. Mais j’étais curieux, je voulais ramener quelque chose pour le journal. Au lieu de faire du commentaire de commentaire, on aurait quelque chose qui viendrait directement du terrain. Ce voyage m’a aussi fait prendre conscience de quelque chose de très profond sur la construction européenne. Il était évident pour moi que l’on devait construire l’Europe ne serait-ce que pour la paix entre ses peuples. En Yougoslavie, j’ai vu tout un pays en dépression nerveuse et c’est terrible, sidérant. Cette guerre a été un moment d’Histoire fondamental pour nous Européens.
La guerre est grave, tragique, mais votre livre revêt aussi un aspect comique, du genre « les pieds nickelés en Bosnie ». Pourquoi cette tonalité alors que pleuvent les bombes, les balles et les atrocités ?
Je voulais ce contraste, qui vient de ma lecture de Spinoza qui disait qu’il y a deux grands affects humains : la joie et le tragique. Le réel est tragique, et si on ne le prend pas en rigolant de temps en temps, en jouissant de la vie comme on peut, en étant le moins dégueulasse possible avec les autres, alors on loupe quelque chose. Je souris de l’absurdité tragique du réel, sans la moindre croyance : dieu n’a rien à nous dire, et la nature non plus.
J’avais à cœur dans mon livre de montrer que ceux qui ne pensent pas comme moi ont aussi des arguments solides.
Le livre est riche en longs dialogues politiques, philosophiques, métaphysiques. On sent dans ces passages que vous faites passer votre vision du conflit yougoslave, plutôt pro-bosnienne, mais vous ne caricaturez pas la position pro-Serbe de vos adversaires à qui vous prêtez des raisonnements tout aussi construits et argumentés que les vôtres. Vous vouliez penser contre vous-même, ou vous contredire avec sérieux pour mieux affermir vos positions ?
Oui. Je suis un fervent lecteur des romanciers du XVIIIe et XIXe siècle et je suis toujours étonné, par exemple chez Hugo dans Quatre-vingt-treize, de voir à quel point certains de ses personnages opposent des arguments magnifiques à la pensée d’Hugo. Balzac a fait ça aussi dans plein de ses romans. Et je suis effaré de voir qu’après Proust, grosso modo, cet art de faire parler l’Autre a disparu. On a eu de grands talents monologuant, mais on ne peut pas dire que des écrivains comme Gide ont donné la parole dans leurs écrits à ceux qui les contredisaient. Le roman français au XXe siècle a souffert de cette carence. Les écrivains se sont mis à adhérer au Parti Communiste, ou au fascisme, et la morale n’avait plus lieu d’être pour eux quand il s’agissait des adversaires. Alors en effet, j’ai essayé de faire parler l’Autre. J’avais à cœur de montrer que ceux qui ne pensent pas comme moi ont aussi des arguments solides. Et je regrette qu’aujourd’hui, ce genre de dialogue ne se passe plus nulle part. Milan Kundera a très bien travaillé cette question et il nous a apporté cette chose qui est de faire s’affronter des réflexions contraires de façon très belle, très drôle, très articulée. Inconsciemment, je me suis senti autorisé par Kundera d’écrire ce type de dialogues.
Pensez-vous que ce type de débat de haut niveau a été remplacé par la culture du clash télévisuel, où les gens s’invectivent au lieu de s’écouter ?
Oui, mais pas sûr que les débats télé soient les premiers responsables de ça. Je pense que le dialogue est devenu impossible parce que les gens se sont radicalisés et parlent depuis un point de vue qui ne se discute plus. Par exemple, l’antiracisme version Assa Traoré ne se discute pas. Ou alors, pour une partie des écologistes, la nature ne se discute pas. Dans une discussion normale, certains arguments peuvent infléchir un avis ; si on modifie son avis, on a gagné quelque chose. On peut « perdre » une discussion en se rendant à tel ou tel argument de notre interlocuteur, mais en « perdant » ainsi, on gagne aussi en liberté. Or, ce type de processus semble ne plus être possible aujourd’hui. Les opinions sont devenues quasiment théologiques, il n’y a plus d’échange, l’Autre n’a plus aucune importance quand on affirme un point de vue. On ne peut pas parler avec une Caroline De Haas, elle ne changera jamais d’avis d’un iota. Si vous avez le moindre petit désaccord avec elle, vous êtes un con, vous n’y connaissez rien, vous êtes un apostat de la cause. On n’a jamais vu un tribunal de l’inquisition être convaincu par un marane.
Le dialogue est devenu impossible parce que les gens se sont radicalisés et parlent depuis un point de vue qui ne se discute plus. Par exemple, l’antiracisme version Assa Traoré ne se discute pas.
Comment regardez-vous les mouvements contestataires actuels comme le néoféminisme, les nouveaux courants de l’antiracisme, le décolonialisme, qui aspirent à se rejoindre au nom de l’intersectionnalité ?
Tous ces mouvements procèdent de la même forme de pensée : aujourd’hui, on est jugé et condamné pour ce qu’on est et non pas pour ce qu’on fait. Encore une fois, on se retrouve en pleine théologie, dans des pensées magiques qui reposent sur des présupposés qui n’existent pas : l’Origine, Dieu, la Nature, l’autorité morale qui en découlerait… Ce type de pensée ou de croyance a toujours existé, ce n’est pas nouveau. Dans toutes les démocraties, les autorités représentatives ont toujours été contestées : le problème nouveau, c’est quand les élites elles-mêmes adhèrent à la contestation de la démocratie. Après guerre, en France, on a eu une génération d’intellectuels brillants (Sartre, Deleuze, Foucault…) mais qui avaient toujours un point de vue moral, rousseauiste. L’université française est profondément rousseauiste, elle croit à la fiction d’un avenir radieux où tous les hommes se donneront la main.
Vous critiquez sévèrement l’écologie. Pourtant, sans être un « khmer vert », on ne peut que constater le réchauffement climatique et les dégâts de la civilisation industrielle et consumériste.
Au IIIe siècle, Pline écrivait déjà que ça ne pouvait pas continuer comme ça, que l’homme dégradait la nature, etc. Cette pensée se développe donc depuis très longtemps. Elle a été fortement contredite au XVIe siècle par Spinoza, Montaigne, Shakespeare, Molière, avant d’être récupérée au XVIIIe par Rousseau. Groupie de Rousseau, Robespierre a installé la Terreur au nom du Bien. C’est ce type de courant qui réapparaît aujourd’hui sous d’autres formes. Les radicaux écolos, féministes, décoloniaux ne sont pas si éparpillés que ça, ils sont tous dans le même moule de pensée qui se réfère à une morale transcendante. Et je trouve que les élites ne jouent pas leur rôle.
Les opinions sont devenues quasiment théologiques, il n’y a plus d’échange, l’Autre n’a plus aucune importance quand on affirme un point de vue. On ne peut pas parler avec une Caroline De Haas, elle ne changera jamais d’avis d’un iota. Si vous avez le moindre petit désaccord avec elle, vous êtes un con, vous n’y connaissez rien, vous êtes un apostat de la cause. On n’a jamais vu un tribunal de l’inquisition être convaincu par un marane.
Pensez-vous que les personnalités régulièrement vues dans les médias, qu’elles soient intellectuelles ou politiques, appartiennent majoritairement à la mouvance décoloniale, néoféministe ou néoantiraciste ? Ne serait-ce pas plutôt le contraire…
Les universalistes vus à la télé ou dans les médias ne sont pas si nombreux, c’est toujours la même poignée… La Convention Citoyenne voulait mettre la protection de la nature en tête de la Constitution. C’est dingue ! Ils ne se rendent pas compte que c’est exactement ce qu’ont fait les ayatollahs iraniens, à savoir placer au-dessus des institutions politiques une autorité suprême qui dit le Bien et le Mal. Comment oser parler d’écocide ?! « Ecocide », c’est placer la nature au même niveau que les Juifs, les Arméniens ou les Tutsis qui ont été génocidés. C’est délirant !
Il y a aussi l’émergence d’internet, la meilleure et la pire des choses. Quel rôle jouent les nouvelles technologies dans les radicalisations ?
Internet, c’est un moyen de diffusion hallucinant de la moindre connerie complotiste. Autrefois, la bêtise complotiste était artisanale : ces gens avaient quelques feuilles de chou, maintenant, ils disposent d’un outil industriel international. Mon ami Rudy Reichstadt travaille sur les sites complotistes et la jungle de conneries diffusées est hallucinante. Mais internet n’est pas seul responsable. Quand sur un plateau de télévision des choses énormes sont dites par tel ou tel débatteur, souvent le journaliste médiateur ne relève pas, ne corrige pas, parce qu’il ne sait pas. Certains journalistes sont compétents, mais beaucoup ne travaillent pas assez et laissent le robinet ouvert. Penser comme le troupeau, c’est fastoche, ça évite de passer des heures à travailler un sujet. Tout cela fait que la démocratie est fragilisée, notamment sur le pied où elle existe c’est-à-dire la représentation. Le peuple a un contrat tacite avec la représentation mais souvent, la « rue » ne respecte pas ce contrat. La « rue » est minoritaire mais elle a un tel écho que les gouvernants pensent qu’elle est le peuple. Et du coup, ils ont la trouille d’exercer l’autorité pour laquelle ils ont été mandatés : je ne parle pas d’autorité stupide du bâton, mais de l’autorité des institutions démocratiques, qui consiste par exemple à dissiper les fake news, à faire respecter le réel, à rétablir la vérité – pas la vérité absolue qui n’existe pas mais au moins celle des faits. La représentation, c’est fondamental. Dans Le Contrat social de Rousseau figure une condamnation sans appel de la représentation et l’université française, rousseauiste, ne relève pas assez cela. Rousseau a été revendiqué par Lénine, Mao, Pol Pot, mais l’université continue d’être rousseauiste, imperturbablement.
Dans toutes les démocraties, les autorités représentatives ont toujours été contestées : le problème nouveau, c’est quand les élites elles-mêmes adhèrent à la contestation de la démocratie.
Est-ce qu’il n’y a pas une crainte exagérée de ces radicalisations dans la mesure où comme vous le dites, elles sont minoritaires. Les minorités protestataires, qu’elles soient de droite ou de gauche, n’ont-elles pas toujours existé sans pour autant menacer vraiment la démocratie ? Peut-être même attestent-elles d’une bonne santé démocratique ?
Elles sont peut-être minoritaires mais elles sont jeunes, alors que les universalistes ont plutôt plus de soixante ans. La jeunesse d’aujourd’hui va boire dans de drôles de ruisseaux. Le philosophe Clément Rosset disait à ses étudiants « je suis là pour que vous appreniez à penser par vous-mêmes ». Aujourd’hui, trop de profs donnent les outils pour penser non pas librement mais d’une certaine façon. Tout cela en croyant bien faire, comme les premiers Chrétiens.
Les jeunes qui adhèrent à ces nouveaux mouvements radicaux sont justement animés de bonnes intentions, ils se vivent comme progressistes, démocrates et exigent plus d’une république qui ne tient pas toutes ses promesses. Vous ne vous dites jamais qu’ils ont quelque part raison ? Vous ne doutez jamais ?
J’ai des doutes sur un tas de choses mais pas là-dessus. Par exemple, il y a de réelles questions environnementales, il suffit de nager dans la Méditerranée pour s’en rendre compte. Le problème de la pollution est bien réel, et si notre négligence nuit à la « bonne vie », il faut bien sûr agir. Le réchauffement climatique est un problème social et politique et il y a un tas de choses à mettre en place pour le freiner mais ça ne se fera pas en faisant du compost sur son balcon ou en mangeant du boulgour. Ces questions se règleront politiquement, pas avec des bons sentiments. Il est bon que les jeunes s’engagent sur l’écologie mais ces nouvelles radicalités se fourvoient. L’universalisme vient de l’antiquité. La pensée de Montaigne, c’est celle-là : quelle que soit la naissance, tout le monde a les mêmes droits, il n’y a rien avant la naissance et rien après la mort, et il faut faire en sorte que chacun puisse avoir une vie bonne. Si je pense que l’Autre n’a pas droit à une vie bonne, je ne vois pas comment la mienne pourrait l’être. Par conséquent, je ne veux pas qu’on fasse à l’Autre ce que je n’aimerais pas qu’il me fasse. À partir de là, pourquoi remettre en question l’universalisme, ce principe a garanti la paix à chaque fois qu’il a été respecté. Tant que la science ne nous aura pas prouvé qu’il y a un dieu qui a voulu l’univers, la terre, l’humanité, l’universalisme reste pour moi une évidence.
Il est bon que les jeunes s’engagent sur l’écologie mais ces nouvelles radicalités se fourvoient.
Mais vous voyez bien la critique qui est adressée aujourd’hui à l’universalisme : sous couvert d’universel, il aurait surtout profité aux Blancs, singulièrement aux hommes blancs. Que répondez-vous à cette critique ?
Que la république ne soit pas parfaite, qu’il y ait des problèmes économiques et sociaux, personne n’en disconvient. Quand j’étais chansonnier, j’ai beaucoup sillonné la France et j’ai vu comment ça se passait. Dans les associations qui nous faisaient tourner, on rencontrait beaucoup d’immigrés de la génération post-guerre d’Algérie : il n’y avait pas de racisme dans ce milieu culturel, ces jeunes gens voulaient s’en sortir mieux que leurs parents dans un processus d’intégration qui semblait naturel. A l’époque, la république ne faisait pas grand chose pour ses immigrés, et pourtant, l’intégration fonctionnait plutôt bien. Et puis un événement politique a enrayé cette machine d’intégration en France : le retour de Khomeiny en Iran. J’ai constaté à partir de là un rejet progressif des valeurs occidentales alimenté par la propagande islamiste. Avant, la religiosité bigote n’existait pas chez les musulmans de France. Dans les années soixante, je n’ai jamais entendu le mot « islam » ni le mot « juif ». Après le retour de Khomeiny, l’Arabie Saoudite a répandu sa vision rigoriste de l’islam dans tout le monde musulman sunnite à coups de pétrodollars. Mitterrand a alors créé SOS Racisme mais c’était déjà trop tard. Puis on a arrosé les quartiers à coups de subventions jusqu’à aujourd’hui mais ça ne marche pas, parce que de l’autre côté, une partie des populations n’a pas la volonté de s’intégrer dans la république. Dans les années soixante-dix, il existait une critique de notre société, aujourd’hui, ce n’est plus une critique, c’est une condamnation sans appel.
Sans nier la réalité de la radicalisation islamiste ou d’une radicalisation parfois sans cause précise, est-ce que vous ne noircissez pas le tableau ? Beaucoup de jeunes issus de l’immigration parviennent encore à s’intégrer, font des études, deviennent médecins, avocats, fonctionnaires, commerçants, ouvriers, acteurs de la culture ou du sport…
Evidemment. Je ne nie pas que l’intégration fonctionne encore, je dis juste que sous l’effet de l’islamisme existe une montée du rejet des valeurs de la république.
Pourquoi remettre en question l’universalisme, ce principe a garanti la paix à chaque fois qu’il a été respecté.
Dans le roman, vous écrivez que la guerre en ex-Yougoslavie était une réplique en miniature de la Seconde Guerre mondiale. N’est-ce pas aussi une préfiguration d’une future guerre hypothétique de tous contre tous sous l’effet des idéologies identitaires montantes ?
Exactement, et c’est pour cela que j’ai écrit ce livre. Un roman doit dire une réalité qu’on ne peut pas dire autrement. J’ai l’angoisse d’une guerre qui balkaniserait l’Europe ou la France, et ça fait longtemps. J’avais été en reportage en Espagne avec Wolinski au début des années 2000 à l’invitation de l’écrivain Manuel Vazquez Montalban, et il nous disait déjà ça : les gens vont se dresser derrière des drapeaux, si ça continue comme ça, ça va être une horreur… Chez certains, il y a clairement un désir de dislocation de la république, de la société, qui s’exprime dans la rue.
L’universalisme est-il encore une idée d’avenir ?
À mon sens, oui, mais je ne sais pas si on verra cet avenir. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas baisser les bras là-dessus, sinon ça voudrait dire qu’on meurt. Mais aujourd’hui ressemble à l’inverse des années soixante-dix : on disait à bas les flics, et maintenant, je peux travailler, vivre, me déplacer parce que des policiers assurent ma protection. On vit une époque où la liberté d’expression est protégée par les tribunaux et contestée par la rue ou les réseaux sociaux. C’est tragique et en même temps passionnant.
Dans le livre, il y a cette image furtive mais magnifique d’une femme qui pose des fleurs à sa fenêtre puis s’assied pour fumer une cigarette, tout cela au milieu du fracas de la guerre et des destructions.
Tout est là. L’action politique doit ou devrait servir à ce que ce genre d’image existe. Pour que chacun, partout dans le monde, ait le droit de mettre des fleurs à sa fenêtre et de fumer une clope.